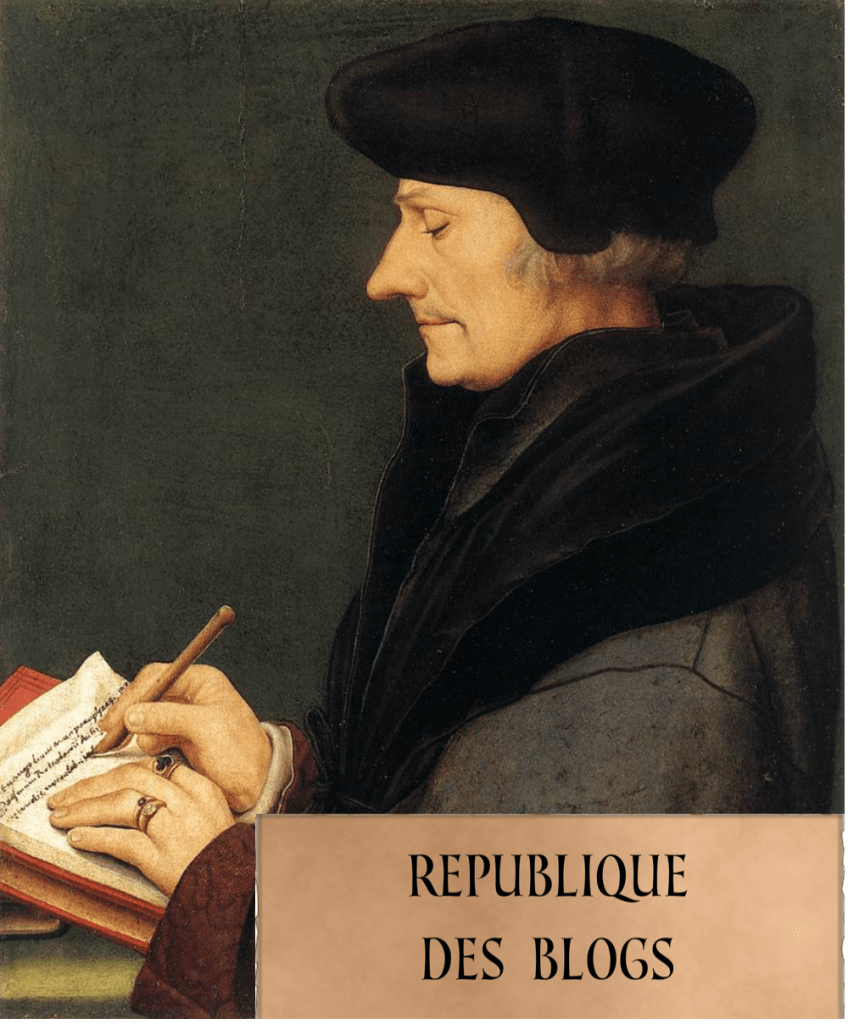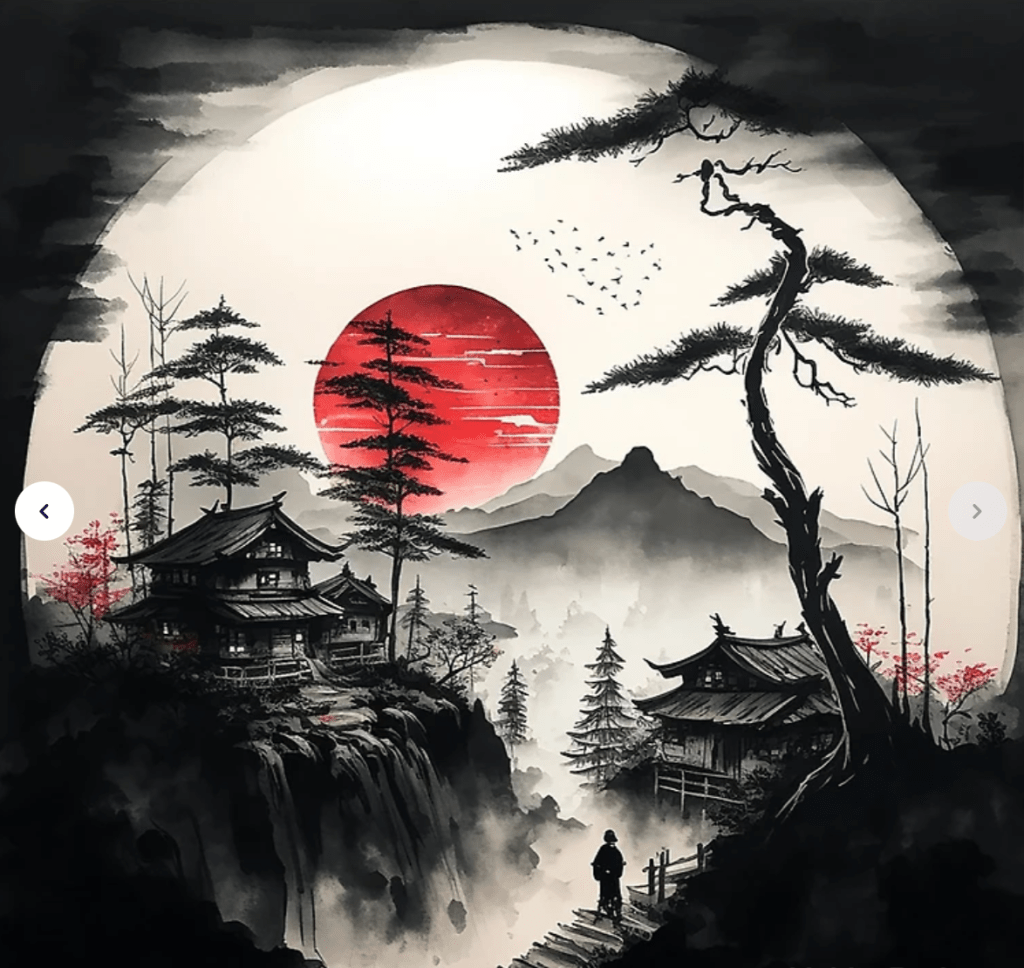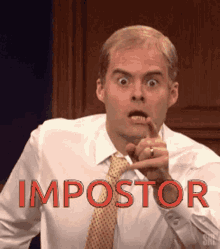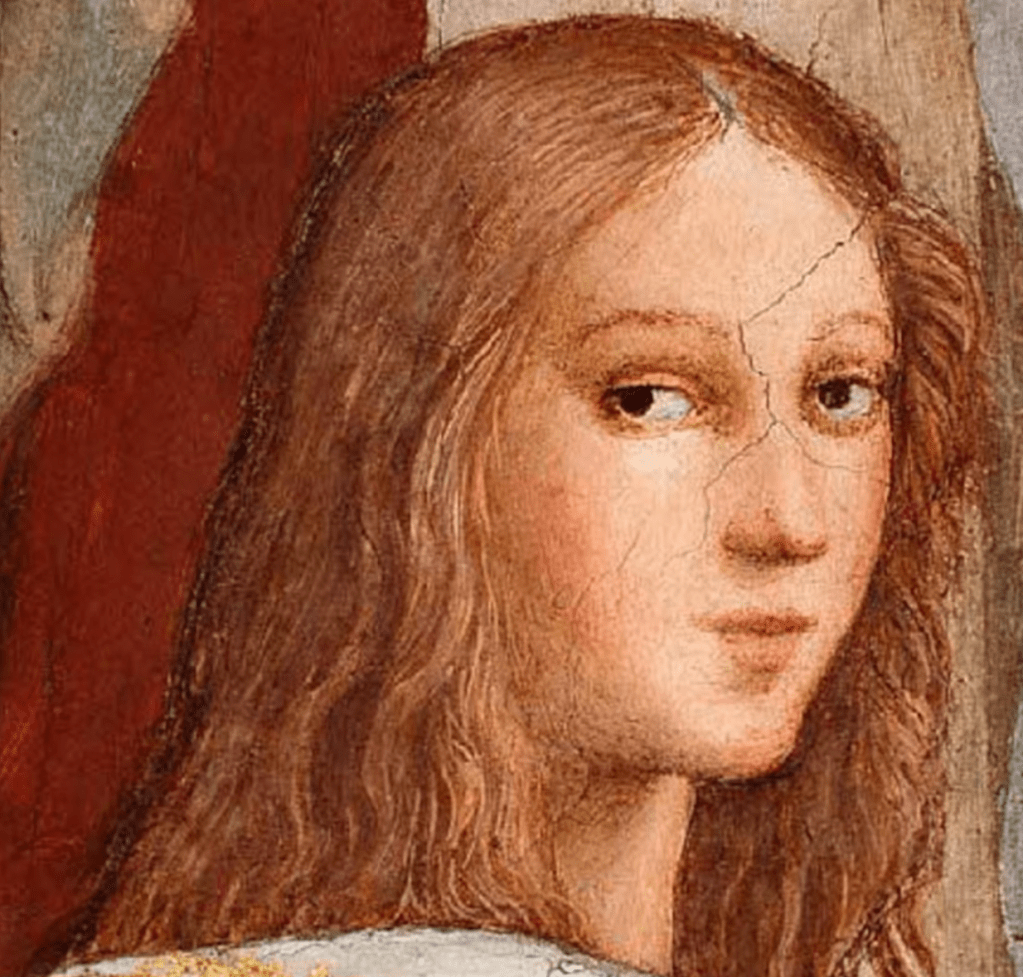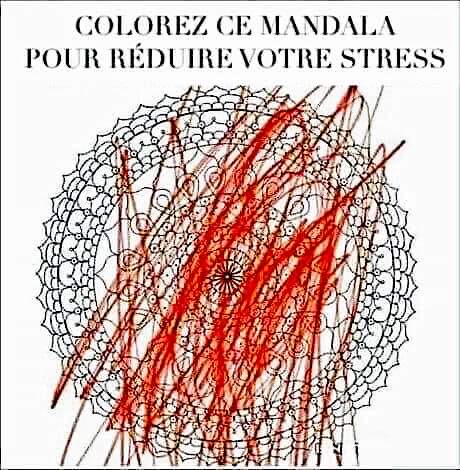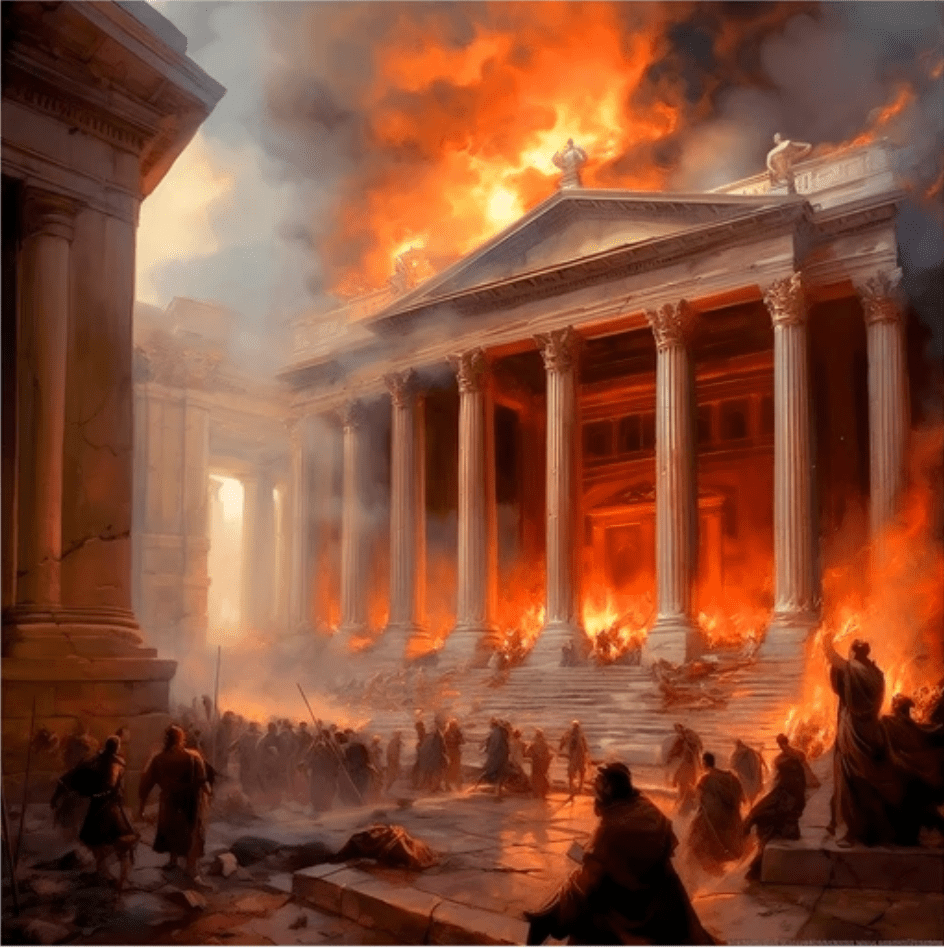Lors de la dernière séance de mon atelier d’écriture sakado, nous avons appris à écrire des haïkus, et découvert qu’en seulement trois lignes nous pouvons susciter de l’émotion, une caractéristique fondamentale de la narration, et pour cause : que je lise un roman ou que je regarde un film, je vis des émotions. C’est ce qui fait que je vais avoir envie de relire un livre ou revoir un long-métrage, parce que j’ai vécu une expérience qui m’a fait rire, pleurer, émerveillé, terrifié, excité…
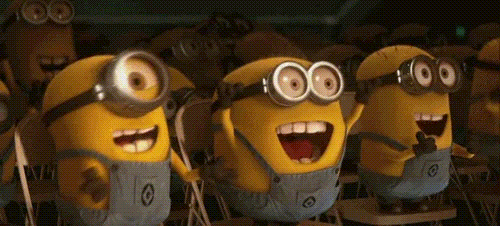
Après avoir composé plus ou moins instinctivement des haïkus, la question que nous sommes en droit de nous poser, c’est comment susciter cette émotion qui captive tant le lecteur ? Une question bien mystérieuse, quand on réalise qu’un haïku de trois lignes peut davantage nous toucher qu’un roman de 1000 pages… Je n’aurai pas l’outrecuidance de vous donner des lois gravées dans le marbre, en revanche je ne prends pas de risques en vous disant qu’il existe un terreau susceptible de favoriser l’émotion, à l’image de la vraie vie…
Il y a deux ans, j’ai connu la pire dépression de mon existence. Je prenais deux médicaments différents qui avaient pour effet de lisser mon humeur. Tout était « pas mal » : la lecture d’un bouquin, le visionnage d’un film, une exposition au musée… et je n’arrivais plus à écrire. Un beau jour, comme j’allais beaucoup mieux, avec l’accord de mon médecin, j’arrêtais mon traitement. Quelque temps plus tard, je sortais de la gare de Metz lorsque je fus surpris par la pluie. Je sentais les gouttes d’eau dégouliner sur mon visage, c’était une expérience d’une sensualité incroyable, si intense que je suis resté en plein milieu de la rue, les yeux fermés, à apprécier ce moment que je n’avais pas vécu depuis si longtemps. Ce soir-là, j’éprouvais à nouveau des sensations et, par conséquent, ces sensations ont amené une émotion. Le terreau de l’émotion, c’est donc le sensorium, l’utilisation des cinq sens, car via le sensorium on amène de l’immersion. Immersion et émotion sont les deux faces de la même pièce, à l’image de la vie.
Pour s’épanouir, une fleur a besoin de sentir la lumière du soleil, mais aussi d’eau et de terre… Comme en amour, elle a besoin de vivre une expérience sensorielle.

Pour s’épanouir dans sa lecture, le lecteur a, lui aussi, soif d’expériences. Or, en tant qu’autrices et auteurs, ce que nous ne devons jamais perdre de vue, c’est que pour le lecteur, un livre est un véhicule. C’est ce véhicule qui va lui faire vivre une histoire, bonne ou mauvaise. Si le véhicule est confortable, et que le lecteur est bien installé, alors il aura une bonne expérience. Les Anglo-saxons parlent de show don’t tell, « ne le dis pas, montre-le ». Il s’agit d’une technique visant à faire passer des sensations et des émotions avant des informations. On peut illustrer cela en prenant un contre-exemple qu’il faut absolument éviter, ce que j’appelle le syndrome du comptable.
Exemple :
L’animateur de l’atelier d’écriture mesurait deux mètres de haut pour cent kilos. Il parlait en se déplaçant et sentait mauvais.
Ce qui ne fonctionne pas dans cette séquence, c’est le catalogage. Pour décrire, on dresse une liste, c’est très statique.
Version alternative :
Quand l’animateur s’approcha des tables, l’ombre de son immense silhouette recouvrit son auditoire. Il marchait vite, et parlait tout aussi rapidement, si près d’une participante de l’atelier d’écriture qu’elle pouvait sentir sa sueur.
— Est-ce que… vous comprenez… ma technique… narrative ? s’inquiéta l’animateur, essoufflé.
La participante recula, écœurée par l’odeur d’oignon de l’animateur. Sous l’effet de la nausée, un goût acidulé envahit sa bouche. Elle s’agrippa à sa chaise, si fort que la texture du plastique crissa sous ses ongles.
Ce show don’t tell est infiniment plus efficace que la première séquence descriptive : il fait appel au sensorium, aux cinq sens. Il y a également du mouvement, le personnage se déplace… La description est dynamique.
Le seul inconvénient du show don’t tell, c’est qu’il nécessite plus de mots que du simple tell. La seconde version est plus longue que la première, mais le résultat est incomparable, car le récit est plus vivant et davantage immersif.
Une simple description peut amener quantité d’émotions, comme par exemple la nostalgie. On en vient à la fameuse madeleine de Proust. On a tous le souvenir d’un plat délicieux qu’on adorait durant notre enfance. Essayer de faire ressentir toute cette gamme de sensations, la première fois qu’on découvre un aliment délicieux, c’est quelque part, amener cette nostalgie. Retirer les sens, c’est appauvrir le texte.
Exemple :
À la vue du coucher du soleil, elle ressentit de l’émotion.
De quelle émotion parle-t-on ? De l’émerveillement, de la tristesse ? On ressent surtout de la mise à distance, c’est très pauvre.
Version alternative :
À la vue des derniers rayons de lumière sur les vagues, elle sourit. Voilà donc à quoi ressemblait l’océan.
On peut aussi casser les clichés et jouer sur le contraste entre une description et un contexte. Exemple : un enterrement qui se déroule par un temps magnifique. Décrire un beau soleil, les arbres en fleurs, peut accentuer la cruauté de ce moment.
Sur la forme, le show don’t tell demande un peu de technique. Il faut en effet prendre soin d’éviter, quand c’est possible, les verbes de mise à distance comme :
les verbes de réflexion
Penser
Savoir
Comprendre
…
les verbes de perception
Voir
Percevoir
Sentir
…
Abuser de ces verbes parasite l’immersion, le lecteur reste à la surface des émotions, de l’action…
Exemple :
Tartempion marchait dans la ruelle lorsqu’il aperçut un homme lui barrer la route, il pouvait voir sa cagoule lui masquer le visage. Il distingua un couteau dans la main de l’inconnu, il n’arrivait pas à y croire. Tartempion se demandait si quelqu’un pouvait lui venir en aide.
On écrira plutôt
Tartempion leva la tête. Un homme cagoulé lui barrait la route. Qu’est-ce que… Un couteau… Il avait un couteau en main ! Comment fallait-il réagir ? Peut-être qu’il pouvait encore appeler à l’aide ?
Le show don’t tell peut même s’appliquer aux dialogues. Imaginez une scène dans laquelle un animateur d’écriture parle ainsi :
— Chères participantes et participants de l’atelier d’écriture, comme vous le savez, nous devons tous ensemble écrire un récit captivant. J’espère que nous allons y arriver, je n’ose imaginer ce qui se passerait si c n’était pas le cas.
— Mon Dieu, c’est terrible, répond une participante. Je suppose que nos histoires doivent être immersives ?
Cette réplique n’est pas crédible, le dialogue est trop écrit, notamment la formule de politesse « Chères participantes et participants » au début. On a aussi le « comme vous le savez », et aussi ce que j’appelle une facilité scénaristique : « je n’ose imaginer ce qui se passerait si ce n’était pas le cas ». On essaie maladroitement d’insérer un enjeu, et de préparer le lecteur, mais c’est trop artificiel pour fonctionner, car dans un dialogue on ne s’exprime pas ainsi. Mention spéciale au « Mon Dieu c’est terrible » : à force de lire de la littérature anglo-saxonne (contre laquelle, personnellement, je n’ai rien, bien sûr), ou voir des films, on finit par reprendre inconsciemment des clichés qui font tache dans nos récits comme le « Oh my God », alors qu’en France on ne dit pas ou plus « Mon Dieu ».1. La question, « je suppose que nos histoires doivent être immersives » est tout autant à côté de la plaque, parce qu’elle évidente, elle n’apporte rien de plus au récit.
Maintenant, imaginons une autre version dans laquelle un participant me pose une question :
— Quelles sont les techniques pour rendre un récit plus immersif ?
— Cela dépend ce que vous entendez par « plus immersif ». Vous parlez de show don’t tell ou de sensorium ?
En l’espace de deux répliques, l’échange est moins artificiel, plus naturel, et surtout plus authentique : les deux personnages savent de quoi ils parlent. L’échange devient show don’t tell.
Beaucoup d’auteurs ont essayé de le théoriser. Le plus célèbre d’entre eux est Ernest Hemingway, avec sa célèbre théorie de l’iceberg. Hemingway écrivait que
Si un auteur connaît assez bien son sujet, il peut omettre des choses et s’il est bon, le lecteur aura le sentiment de connaître ces choses aussi bien que si l’écrivain les avait couchées sur le papier. La masse visible d’un iceberg représente seulement un huitième de sa surface totale.
Ce qu’Hemingway voulait faire comprendre à propos du show don’t tell, c’est que le lecteur n’a pas besoin de TOUTES les informations possibles et imaginables pour plonger dans un récit, et cela vaut aussi pour le sensorium. Parfois, moins c’est mieux. Entendre des gouttes tomber sur le plancher peut donner à penser que c’est de l’eau… et que c’est totalement anodin. Mais que se passe-t-il si vous êtes mécanicien dans un sous-marin et que vous écoutez ce bruit dans un compartiment qui est censé être étanche ? Ou bien dans une maison réputée hantée ? On peut imaginer tout un tas de choses en entendant ces gouttes tomber, peut-être s’agit-il de sang… C’est la fameuse image bouddhiste de la corde qu’on prend, dans le noir, pour un serpent : dans certains cas, donner au lecteur des informations à la façon d’un peintre impressionniste, de façon minimale, peut être très efficace.
Une odeur de renfermé peut inconsciemment influencer le lecteur. Vous allez peut-être retrouver avec plaisir l’odeur des livres de cette bibliothèque, cela va réveiller en vous de la nostalgie…. Ou au contraire, votre personnage ne va pas supporter cette effluve, qui va lui rappeler son enfance, parce que son père était un bibliothécaire tortionnaire qui lui forçait à lire des livres religieux ?
Parfois, on veut écrire tellement vite qu’on oublie le show dont’ tell pour utiliser des facilités. Le contraire du show don’t tell s’appelle les « clichés ». Comme on a du mal à décrire l’état d’esprit d’un personnage, on va au plus vite en employant par exemple des expressions telles que « à couper le souffle », « le cœur gros ».
C’est un peu de la fainéantise, parce qu’il s’agit d’expressions figées qui sont très répandues dans les livres, et qui appauvrissent le texte. Elles ont été popularisées par des best-sellers. Comme nous écrivons machinalement ce qui a été employé des milliers de fois avant nous, ces expressions deviennent des clichés à la mode qui nous contaminent. L’idée n’est pas d’éliminer tous les clichés d’un roman, mais il faut autant que faire se peut, essayer de les désamorcer, car ils nuisent à l’émotion. Les exemples sont innombrables : on peut abuser d’adjectifs :
Le soleil radieux se leva dans le ciel azuré, répandant sa lumière dorée sur le vaste horizon.
Les clichés ne se retrouvent pas seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, et concernent tous les genres littéraires. Les exemples sont, là encore, infinis.
En romance, on peut citer :
— Le trio amoureux (X aime Y qui est amoureux(se) de Z).
— Le jeune paysan orphelin au sang royal qui va découvrir grâce à une prophétie qu’il est l’Élu et sauver le monde
— L’inspecteur de police alcoolique
— La femme fatale-toxique d’un polar
— Le cliché météo : commencer un roman comme le fit l’auteur du XIXe siècle Edward Bulwer-Lyttonpar avec sa fameuse description « C’était une nuit sombre et orageuse »… la pire introduction de l’histoire de la littérature.
— Le vieux mentor qui est là pour instruire le héros, mais qui disparaît au milieu de l’histoire. Exemple : Gandalf dans le Seigneur des Anneaux.
Le vocabulaire des clichés est interminable. Essayez d’en repérer dans ce texte aussi bien sur la forme que sur le fond…
Alors que la nuit était sombre et orageuse, l’inspecteur remontait la rue, croisant au passage une femme aux longues jambes fuselées dont les cheveux avaient la blondeur des blés. Sa beauté était à couper le souffle, mais il ne s’attarda pas, ses pensées étaient ailleurs. Il pénétra dans un immeuble et s’arrêta devant l’ascenseur, toujours en panne.
– Comme d’habitude, grommela-t-il.
Le regard teinté d’ironie, il montra les marches quatre par quatre et parvint au troisième étage, jusqu’à la porte de son appartement, un trente mètres carrés. Il entra sans prêter attention à son salon miteux, prit une bouteille de scotch pour étancher sa soif, et s’assit sur son fauteuil, dans un silence pesant.
– Sale mois pour arrêter l’alcool, murmura-t-il avant de boire une rasade au goulot.
ll aperçut son reflet dans le miroir, et observa son visage buriné taillé à coups de serpe, le visage d’un flic qui avait vu trop d’affaires non résolues creuser des rides prématurées sur son front. Il but une nouvelle gorgée, regarda le dossier posé sur la table et examina enfin la photo de la victime avec une froide détermination.
Laura.
La femme aux yeux d’un vert émeraude baignait dans son sang. Une tristesse sans fond envahit l’inspecteur. Qui avait pu commettre un crime pareil ? Il manquait cruellement d’indices. Il comprenait que pour la brigade scientifique, il s’agissait d’une affaire comme une autre, et pourtant il ne pouvait oublier le sourire de Laura, son charme indéfinissable, ainsi que son parfum envoûtant. Ce meurtre avait laissé sur lui une marque indélébile, jusqu’au plus profond de son être. Alors que le moteur d’une voiture vrombit dans le lointain, il se rappela son passé avec Laura. Ils avaient vécu une liaison tumultueuse, mais il réalisait que plus jamais il n’aurait l’occasion de lui parler de ce sentiment d’inachevé, la faute à ce salaud qui lui avait ôtée la vie. Tandis que la colère l’envahissait, il se prit à imaginer ce qu’il allait faire au tueur lorsqu’il aurait mis la main sur lui. Un frisson lui parcourut l’échine.
Consignes d’écriture (au choix)
Consigne 1 : madeleine de Proust
Prenez le temps de méditer une minute, puisdécrivez la sensation que vous éprouvez en pratiquant votre activité favorite que ce soit un sport, la dégustation d’un plat particulier, de la peinture… peu importe.
Consigne 2 : privation sensorielle
Fermez les yeux et méditez pendant une minute, puis écrivez une séquence dans laquelle votre personnage est privé d’un sens.
Consigne 3 : réécriture
Reprenez le texte de l’enquêteur de police alcoolique, et essayez de le réécrire en supprimant tous les clichés, aussi bien sur la forme que sur le fond… Bon courage…
Astuce commune aux trois consignes : évitez le plus possible les verbes de mise à distance
les verbes de réflexion
Penser
Savoir
Comprendre
Réaliser
Vouloir
Se rappeler
Imaginer
Désirer
Se douter
Déduire
Deviner
Se demander
Croire
les verbes de perception
Voir
Percevoir
Apercevoir
Sentir
Distinguer
Observer
Examiner
1. Un autre anglicisme me donne envie de tuer des bébés pandas : « je suis dévasté par cette nouvelle »… qui vient de l’anglais « to be devasted ».
Liste des précédentes sessions de l’atelier d’écriture sakado
Introduction : sakado, l’art de l’écriture
Séance 1 : huit milliard d’imposteurs
Séance 2 : zen et taoïsme dans la poésie japonaise