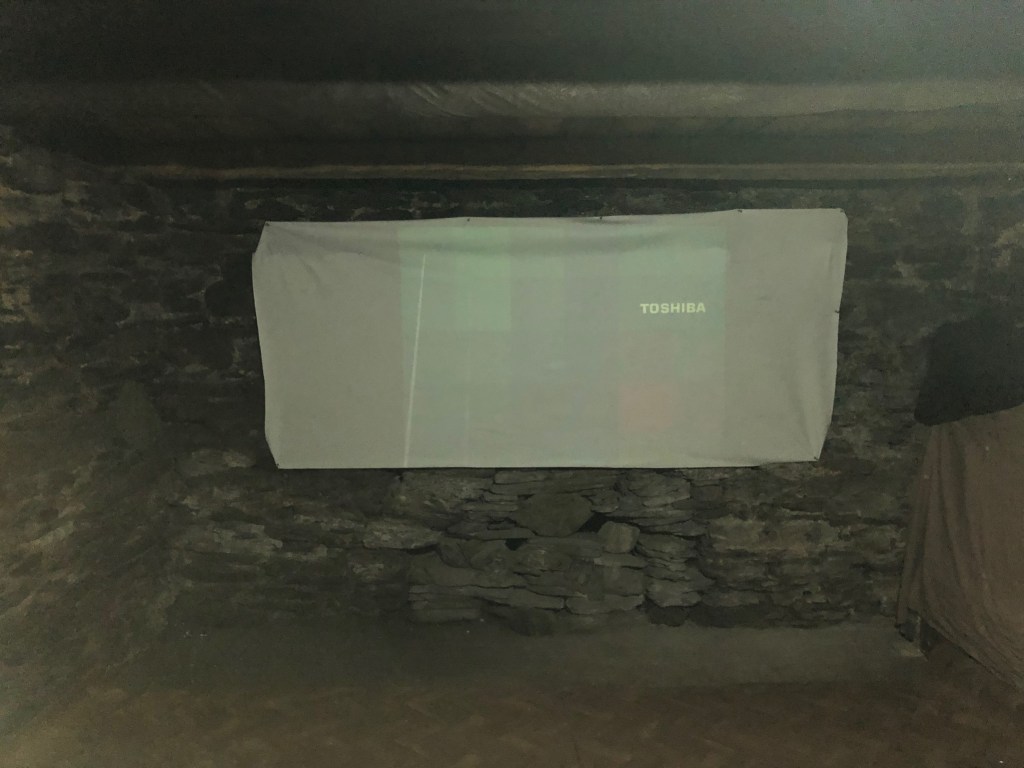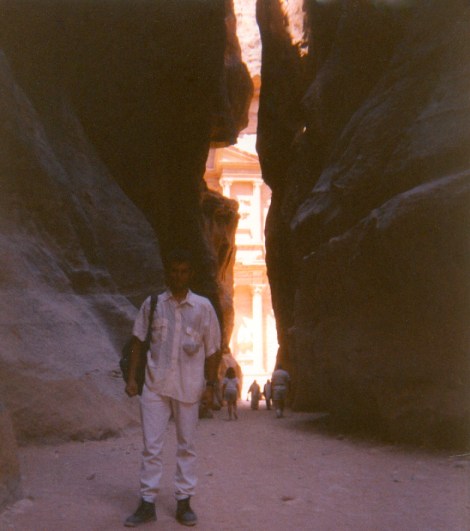Me voici de retour sur ce blog, avec le redoutable privilège d’écrire un (très long) article dans lequel le sublime le disputera au pathétique au sein de ce qui demeurera l’un des plus beaux voyages de toute ma vie, une aventure inoubliable dans les montagnes du Caucase… après m’être entrainé quotidiennement en forêt pendant ce fameux « été lorrain », si généreux en pluies.

Je tiens à vous prévenir d’avance : ce billet n’est qu’un « bref » condensé de ce voyage, qui mériterait un livre à lui tout seul tant il est digne d’un film de Wes Anderson…
L’espace d’un été, la Géorgie est devenue la Jupiter de mon imaginaire, je suis en effet parti là-bas pour écrire et aussi, je dois bien l’avouer, faire le point sur ma vie. Pourquoi diable cette destination ? Parce que ses frontières étaient ouvertes… et parce que, des années auparavant, j’avais lu par hasard un article sur les coutumes aussi ancestrales que mystérieuses des peuples du Caucase. Je pense que mon grand-père linguiste m’a transmis son amour des langues et de l’anthropologie. De son vivant, il invitait à manger chez lui son ami Mircea Eliade, un grand savant que j’aurais aimé connaître, spécialisé dans les mythes et la religion comparée. Cet été, j’avais l’intuition bizarre que mon grand-père aurait été heureux que j’accomplisse ce voyage, au point où cette étrange intuition ne me quittait plus.
Là-bas, j’ai découvert le pays le plus étrange qu’il m’ait été donné de visiter, la frontière entre l’Orient et l’Occident. Il m’a fallu plusieurs semaines pour « digérer » tout ce que j’ai vécu, car absolument rien ne s’est passé comme prévu ! Du premier jusqu’au dernier jour, ce périple fut une surprise permanente tant la Géorgie est une contrée difficile à cerner, pour ne pas dire insaisissable, comme si l’Europe se terminait ici. Imaginez…
… une capitale, Tbilissi (à seulement 200 kilomètres à vol d’oiseau de Grozny, en Tchétchénie) marquée par la période soviétique avec un métro doté d’escalators vertigineux, des thermes antiques encore en activité
… de magnifiques églises orthodoxes très anciennes
…. un réseau Internet gratuit dans toute la ville, une tour de l’horloge bâtie par le maître marionnettiste Redzo Gabriadze avec un ange-automate qui sort de l’édifice sonner une cloche… le tout, par une chaleur de 37 degrés. Imaginez tout cela et vous serez encore loin du compte.
Alphabet exotique, horaires ésotériques… La moindre initiative devenait compliquée.


J’eus plusieurs fois l’impression de me retrouver dans un monde (rétro)futuriste à la Blade Runner…
Un univers parallèle, mention spéciale à ce bazar souterrain qui n’était pas sans rappeler Istanbul, que je connais bien : à un moment donné, une femme habillée de manière traditionnelle, avec de longs vêtements sombres, s’approcha de moi… avant de pointer sans crier gare un pistolet thermique devant mon front. Elle mesurait ma température pour déterminer si je ne souffrais pas du Covid !


Seul élément familier auquel je pus me raccrocher, cette étrange coïncidence : la rue s’appelait Mikhaïl Lermontov.

Intrigué, je ne pus m’empêcher de sourire, car mon grand-père avait traduit ce poète. Lermontov est l’auteur de l’un des plus grands romans russes du XIXe siècle, Un héros de notre temps, livre que je n’avais jamais pris la peine de lire. Je ne m’étais pas trompé, l’ombre de mon grand-père planait sur ce voyage, mais à un point que je ne pouvais soupçonner.

Au fur et à mesure que je me familiarisais avec ce monde exotique, je découvrais qu’il n’allait pas de soi de dire « bonjour » (« gamarjoba ») ou « merci » (« madloba »). Se montrer trop poli était considéré comme de l’hypocrisie. Il fallait également s’affirmer pour ne pas se faire plumer et vite oublier sa timidité, surtout dans certaines provinces où les prix sont souvent fixés à la tête du client… Je ne parle pas du traditionnel (et sympathique au demeurant) marchandage, tel que j’ai pu le pratiquer dans les pays arabes, mais bien de tarifs à géométrie variable, sans parler de ce qui relève de l’implicite : à Gori, dans plusieurs cafés on refusa de me servir. Les habitants, aussi froids que susceptibles, me prenaient pour un touriste russe. Je ne leur en veux pas, car en 2008 la ville avait été, malgré le cessez-le-feu, meurtrie par les bombardements commandités par Moscou, bombardements qui causèrent de nombreuses victimes et beaucoup de ressentiment. À vrai dire, cette ville était très étrange, surtout son musée à la gloire de l’enfant de Gori, Staline, un musée malaisant peuplé de tableaux de propagande mettant en scène le dictateur aux côtés de gosses ou de paysannes. Pas une seule fois l’existence des goulags ne fut mentionnée. « Il y a plusieurs versions de ces histoires », répétait une guide du musée, un tantinet gênée.

Passé ce choc culturel, je pris le temps d’apprécier des villes magnifiques, comme Akhaltsikhé et sa forteresse dans laquelle des mosquées turques furent érigées à l’époque de l’Empire ottoman.
C’est dans cette ville que vécurent les parents de Charles Aznavour, ainsi qu’une importante communauté arménienne qui avait fui le génocide. J’eus d’ailleurs la chance de dormir dans un gite tenu par un adorable couple d’Arméniens, des personnes âgées qui n’avaient de cesse de me servir des « petits » déjeuners pantagruéliques !
Les déjeuners n’étaient pas en reste, avec des variétés régionales qui témoignaient des particularismes locaux. En découvrant ces villes qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, je comprenais que la Géorgie rassemblait une mosaïque de peuples aux histoires épiques, on raconte qu’Alexandre le Grand lui-même livra bataille au pied du château de Khevitsi.

La Géorgie, ce pays des trains vétustes contrôlés par des femmes d’un certain âge aux coupes de cheveux austères, qui rappellent des commissaires politiques de l’URSS. Malheur aux resquilleurs, qui se faisaient littéralement hurler dessus dans le wagon ! Pour rien au monde, je n’aurais aimé être à leur place.
Arrivé à une petite gare de province, je constatais que le (passionnant) chauffeur envoyé par mon gite était un ancien militaire soviétique au volant d’une Lada tout droit échappée de la guerre froide !

Grâce à ce chauffeur, je découvris des paysages aussi sublimes que variés : des plaines semi-désertiques abritant des sites archéologiques à la fois improbables, méconnus et captivants, comme la cité troglodyte de Ouplistsikhé, ravagée par les Mongols au XIIIe siècle.

Au moment de faire mes adieux à ce chauffeur, je le remerciais en utilisant la formule de politesse la plus soutenue possible, ourhgmesi madloba, « merci infiniment », très difficile à prononcer pour qui ne sait pas rouler les « R » à la façon orientale, ce qui ne manqua pas de le toucher. J’en profite pour vous donner votre premier cours de géorgien, répétez après moi :
Pour gagner du temps, je pris l’habitude de maîtriser des expressions clefs plutôt que la langue dans son ensemble, et je dois avouer que cela m’ouvrit parfois des portes. J’alternais les moments de marche et les voyages en marchroutki, l’incontournable taxi collectif. Je rencontrais différents chauffeurs, mais tous appliquaient une règle immuable : doubler une voiture au moment où un camion apparaissait en face sur l’autre voie, en se basant sur le postulat que ce même camion ralentirait forcément. Si, au premier jour, cette pratique me donnait la certitude que j’allais mourir sous peu, à la fin du séjour j’étais tellement habitué à cette conduite suicidaire que je n’y prêtais même plus attention. Ces chauffeurs ne manquaient pas de personnalité. J’ai connu :
- le chauffeur mélomane qui écoutait du Britney Spears dans un véhicule prévu pour 16 personnes… et qui transportait en réalité 21 passagers. Debout dans son marchroutki, je constatais rapidement que ce chauffeur roulait à tombeau ouvert en montagne, tandis qu’un Géorgien alcoolisé me parlait en me surnommant « le Mexicain » à cause de mon chapeau.
- Le chauffeur dragueur qui faisait la conversation à la blonde assise à côté de lui, au point d’oublier régulièrement de surveiller la route. La seule fois où nous empruntâmes l’autoroute, il s’arrêta pour laisser embarquer… un voyageur qui l’attendait tranquillement sur le bas-côté. Quelques minutes plus tard, un autre passager descendit du véhicule sur cette même autoroute, une valise à la main… sans craindre la circulation.
- Le gamer qui esquivait les vaches sans ralentir, comme dans un jeu vidéo. Ces animaux sont tellement répandus sur les routes de Géorgie qu’on finit par ne plus leur prêter attention.
- Le chauffeur-pêcheur. Comme son nom l’indique, au moment où je visitais un château, il s’en allait pêcher du poisson au bord de la rivière, à l’aide d’une canne qu’il rangeait dans son coffre. À la fin de ma visite, je partis à sa recherche en longeant le cours d’eau. Lorsque j’arrivais à sa hauteur, il me fit signe d’attendre…

Visiblement, ce jour-là il y avait du poisson. J’en profitais pour admirer la belle rivière, méditant sur le constat qu’en Géorgie on prenait son temps, y compris lorsque, au restaurant, il fallait parfois patienter plusieurs heures avant de pouvoir déguster les khinkalis, les meilleures ravioles au monde.

Plus je me rapprochais de la frontière de la République autonome d’Abkhazie, et plus l’ambiance était « particulière ». Il faut dire qu’il n’y a qu’un seul pont reliant la Géorgie à l’Abkhazie, ce qui donne lieu à toutes sortes de trafics. Un jour au restaurant, alors qu’il faisait mauvais temps, des gardes du corps munis de lunettes de soleil accompagnèrent un type au visage patibulaire, et dont la compagne, une blonde vulgaire scotchée à son smartphone, se faisait royalement chier. D’où ce selfie pris discrètement avec l’un des porte-flingues tout droit sorti de Breaking Bad…

Je prenais soin de ne pas dépasser la ville-frontière de Zougdidi, car l’Abkhazie est un état séparé de la Géorgie, seulement reconnu par la Russie et une poignée de pays. Étant donné que la France ne reconnait pas l’existence juridique de l’Abkhazie, s’il m’arrivait quoi que ce soit là-bas, il n’y aurait pas eu d’ambassade pour m’aider ! Je me contentais donc de prendre la pose devant l’élégant panneau « I love Zougdidi », face à des Abhkazes médusés de croiser un étranger dans un lieu si improbable.

Bon, je suis sévère, Zougdidi est une très jolie ville, oubliez le panneau touristique kitch :
Pendant ce drôle de voyage, je m’émerveillais devant la beauté des plages désertes de la Mer Noire, aussi sauvages que la Côte d’Azur au XIXe siècle.
J’étais étonné par l’exotisme improbable des marécages de Poti, la volupté des vignes géorgiennes, les plus vieilles du monde selon certains historiens qui estiment que le vin serait né là-bas vers 6000 ans avant J.-C. Un soir, je dormais chez un sympathique jeune viticulteur qui avait transformé son domaine en gite, au point où je me retrouvais dans « l’obligation » de boire ce vin rouge ancestral au goût particulier.
Il était très fort, comme tous les vins géorgiens, qui plus est par grande chaleur… alors que je n’avais pas touché à une goutte d’alcool depuis des années. Accidentellement éméché, je fis la connaissance d’un sympathique couple d’Espagnols. La femme, une Catalane, avait visité tous les pays d’Amérique du Sud possibles et imaginables avant de revenir en Europe. « La cocaïne, beaucoup trop dangereux », disait-elle en riant, elle aussi un peu grivoise… Avait-elle été impliquée dans de sombres trafics ? Notre ébriété mutuelle était-elle à l’origine d’un malentendu ? Je ne le sus jamais, car je repartais tôt le lendemain matin avec la gueule de bois pour la cité sainte de Vardzia, taillée dans la montagne.


Cette ville troglodyte me fascinait, à mesure que j’empruntais son réseau souterrain, un labyrinthe de tunnels et de chapelles destinés aux moines orthodoxes.

Puisqu’il est question de religion, je fus constamment frappé par l’attitude des Géorgiens : les chauffeurs se signaient chaque fois qu’ils passaient devant des monastères et autres lieux saints, avec une ferveur qui rappelle l’Europe de l’Ancien Régime, une ferveur qui ne manquait pas de m’impressionner.

Nul n’entrait dans une église orthodoxe sans se couvrir les jambes, et toujours en silence. J’assistais par hasard à un office dans l’Église de la nativité de Tbilissi qui m’émut. Le prêtre lisait à la façon de mantras des passages de la Bible :
Je découvrais des ponts entre le christianisme, l’Islam et l’Extrême-Orient, le chapelet du prêtre n’était pas sans rappeler les malas bouddhistes, hindouistes et les chapelets musulmans. On aurait dit qu’une ambiance orientale soufflait sur ces églises… et pourtant, force est de constater que le paganisme survivait encore.
Il avait trouvé refuge dans les montagnes du Caucase, en particulier en Svanétie, une zone difficile d’accès, il faut en effet emprunter des routes sinueuses, avant les neiges hivernales qui peuvent survenir très tôt.
Pour vous donner un ordre d’idée en ce qui concerne l’isolement de ce massif, au XXe siècle, sur une zone frontalière avec la Tchétchénie, la Khevsourétie, on portait toujours… la cotte de mailles ! J’avais pour but de me rendre à Outchgouli, le plus haut village d’Europe, perché à 2100 mètres d’altitude, en passant par Mestia et ses fameuses kochkebi, des tours médiévales défensives qui attestent que la Svanétie était autrefois victime de vendettas, la loi du sang. Ces vengeances n’en finissaient plus.
En fait, ces tours présentent encore aujourd’hui une part de mystère. Alors que les historiens estiment qu’elles sont médiévales, les villageois ne sont pas d’accord et pensent qu’elles sont beaucoup plus anciennes, et dateraient de l’Antiquité. Des rites païens sont associés à ces tours, notamment des pratiques liées à Lamaria, déesse du cœur. Il y avait même jadis une « fête de la tour ». Les participaient circulaient autour d’une tour de neige qu’ils avaient au préalable construite. Un arbre sacré était placé au sommet de l’édifice et une figurine de la déesse était attachée au sommet de la tour. La figurine recevait un poignard et un phallus en bois, son visage était dissimulé. Une danse circulaire était exécutée et l’arbre était secoué, jusqu’à ce que le visage de la figurine tombe. Les enfants du village faisaient alors la course pour grimper dans la tour et faire tomber la figurine de Lamaria au sol. Était-elle par conséquent la déesse des cœurs… brisés ?

Bien que fébrile, je poursuivais tant bien que mal mon voyage, saluant l’impressionnant Mont Ouchba (4700 mètres) au double sommet enneigé, la montagne la plus dangereuse de Géorgie.

Après deux jours de fièvre et une cinquantaine de kilomètres, je réussis à atteindre Ouchgouli, perdu dans le ciel du Caucase, au pied des neiges éternelles… au mois d’août.
Là-bas, les chiens sauvages étaient omniprésents, si affamés qu’ils n’hésitaient pas à s’attaquer aux vaches des paysans. Alors que je dormais dans un champ, je fus réveillé par l’un de ces pauvres chiens aux côtes saillantes, sans que je sache si cette femelle veillait sur moi, devinant à mon odeur que j’étais malade… ou demeurait à mes côtés parce qu’elle me trouvait appétissant. Peut-être un peu des deux…
J’appelais cette chienne « Lamaria », en l’honneur de l’antique déesse géorgienne.

Nous restâmes tous les deux plusieurs heures allongés sur l’herbe, à regarder une grand-mère travailler la terre avec ses petits enfants, qui ne devaient pas avoir plus de sept ans. Entre deux poussées de fièvre, j’avais à peine la force d’écrire. J’avais très chaud, puis très froid, je ne pouvais rien avaler. Était-ce le paludisme, que j’avais pu contracter près des marécages de Poti, qui me tuait à petit feu ? Bientôt, je n’eus plus aucune énergie, je me contentais d’observer cette vieille femme courageuse qui ignorait ma présence. Étrangement, j’éprouvais un grisant sentiment de liberté, parce que je pouvais rester autant d’heures que je voulais aux côtés de Lamaria, couchée sur l’herbe. Dans mon délire fiévreux, elle veillait sur moi, peut-être était-ce vraiment le cas ? Peut-être était-ce Lamaria en personne, la déesse des cœurs brisés réincarnée en animal ? Une déesse-chienne qui avait pitié de cet étranger un peu bizarre qui avait eu la folie de se mesurer au Caucase, alors qu’il n’avait plus vingt ans. Je ne ressentais aucune amertume, c’était une belle journée pour mourir, surtout aux côtés d’une divinité. J’éprouvais une sorte de détachement à l’idée que cette fièvre puisse me terrasser, une paisible résignation que j’associais à un lâcher-prise. Certaines personnes seraient attristées par ma disparition, mais elles s’en remettraient, d’autres s’en ficheraient éperdument, mais une chose était sûre : le monde, lui, ne s’arrêterait pas de tourner. Cette grand-mère devant moi continuerait de cultiver son champ, puis un jour, elle s’éteindrait également, ses enfants et petits-enfants prendraient alors le relais.
En attendant, pour cette grand-mère qui cultivait sa terre, il s’agissait d’une journée comme une autre. Peut-être avait-elle toujours vécu là… contrairement à moi, le Français privilégié qui possédait le luxe de pouvoir voyager. J’étais chanceux. Au même moment, j’eus un vertigineux sentiment océanique, l’intuition que sur Terre, nous autres humains étions tous inconscients de l’aliénante routine du quotidien. Nous passons notre vie à ériger des barrières qui nous inhibent, à nous ranger dans des cases, à perpétuer nos préjugés, à travailler pendant toute notre existence dans un seul pays, quand il ne s’agit pas d’une région… alors que nous pouvons vivre mille vies. Je comprenais enfin la finalité de ce voyage : mon existence ne possédait qu’un sens, celui que je voulais bien lui donner. Ces mille vies… Elles pouvaient être miennes, qu’est-ce qui m’empêchait d’effectuer d’autres voyages destinés à alimenter mes romans ? Qu’est-ce qui m’empêchait de vibrer, passé quarante ans, à partir du moment où j’étais capable de crapahuter ? Les paroles d’une amie me revenaient en tête : « on peut avoir une meilleure condition physique qu’à vingt ans, la seule différence, c’est qu’on récupère moins vite, c’est tout ». La condition physique, j’étais sûr de l’avoir, en France je m’étais entrainé dur. Rien n’était impossible.
Je me relevais, et me rendis péniblement à Ouchgouli. Lamaria me suivit sur plusieurs kilomètres, tandis que je lui parlais avec douceur. La pauvre bête se mit à dévorer de la boue sur le sol, affamée qu’elle était. J’étais résolu à lui donner à manger dès que j’arriverai au village… J’avais tellement envie de la ramener en France ! Mais lorsqu’elle aperçut les tours d’Ouchgouli, elle décida de rejoindre définitivement son monde sauvage. Il était temps de lui dire adieu.

Pourquoi l’existence ne se résumait qu’à une suite d’abandons ? Épuisé par la fièvre et les kilomètres, j’éclatais en sanglots. Je me repris, mais chaque fois que je repensais à elle, les larmes montaient. Moi qui étais prêt à mourir quelques heures auparavant, voilà que je craquais complètement, tout ça parce que je m’étais attaché à une chienne que je connaissais à peine… Avais-je touché le fond ? Qu’est-ce qui ne tournait pas rond chez moi ? Je compris alors que, de toute évidence, j’étais en manque d’affection. Ce voyage me poussait au bout de mes limites, tant physiques que mentales, je souffrais… mais au moins j’en apprenais plus sur moi-même. Ressentir des émotions constituait la preuve que j’étais vivant.
Dans un état second, je visitais Ouchgouli, village dans lequel les personnes âgées pratiquent encore une religion syncrétique animiste. Un autre monde, dans lequel on croit encore en Dieu… et aux esprits des ancêtres. Pour soigner les malades, les anciens ouvrent les fenêtres et donnent aux esprits protecteurs des offrandes posées sur des assiettes, qu’on tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Des bracelets rituels protègent des cauchemars, tandis qu’un mouton est sacrifié pour la fête de Lomisoba. L’église d’Ouchgouli elle-même était à l’origine un temple à la gloire de Lamaria, jalousement gardé par un pope à l’allure sévère qui m’offrit le privilège de visiter son sanctuaire, contrairement à des hommes russes qui avaient eu la folie de se présenter devant lui… jambes nues.

Bien que Lamaria ait été assimilée à la Vierge, une atmosphère païenne subsiste dans cet endroit… ce que je me suis bien gardé de dire au pope qui m’avait laissé entrer !

Ce paganisme syncrétique se retrouve dans tout le Caucase : lorsque les femmes prient un saint, elles le font le ventre allongé sur une pierre, comme lors des rites de fertilité antique, tandis que des portraits sont placés sur des arbres… à la manière des cultes polythéistes, ce qui ne manquait pas de choquer les catholiques du Moyen-Âge !
C’est à Ouchgouli que je vécus probablement la rencontre la plus surréaliste de mon séjour, en découvrant des affiches annonçant avec fierté l’existence d’une salle de cinéma rudimentaire à l’intérieur d’une tour médiévale, cinéma qui, disait-on, projetait plusieurs fois par jour un film, Dede, tourné intégralement à Ouchgouli ! « La plupart des acteurs sont originaires du village », vantait l’affiche. Bizarre…
Visiblement le film avait non seulement été sélectionné dans des festivals comme Sundance et Cannes, mais aussi primé grâce à son scénario, une histoire d’amour impossible où il est question du poids des traditions. Sceptique, je me rendais le soir dans la tour pour assister à la projection de Dede, diffusé via un rétroprojecteur depuis un PC sur un petit mur, tandis que les rares touristes présents autour de moi étaient assis sur des coussins, au milieu de charpentes en bois, aussi étonnés que je pouvais l’être. À ma grande surprise, ce n’était pas un canular ! D’emblée, je fus frappé par la beauté des premières images, avec ces soldats svanes aux visages graves revenant de la guerre… Au fil des minutes, je reconnaissais immédiatement la splendeur d’Ouchgouli, exploitée de façon si magistrale qu’une grand-mère du village jouait son propre rôle avec talent ! Dehors, l’orage grondait en Dolby Surround, donnant à la projection une atmosphère ultra-réaliste. À la fin de la séance, grâce à l’animateur de la soirée j’eus l’immense plaisir de rencontrer l’acteur qui joue le rôle de David (le barbu de l’affiche armé d’un fusil de chasse), dont la sœur n’était autre que la réalisatrice du film !
Dans un moment surréaliste, l’animateur et l’acteur me demandèrent avec gravité si j’avais aimé le long-métrage, et lorsque je répondis par l’affirmative en expliquant que j’avais grandi à Cannes et que j’adorais les films indépendants authentiques tels que Dede, loin d’être blasés par ma critique de fan, ils me remercièrent chaleureusement, aussi heureux que des adolescents qui auraient proposé un court-métrage tourné en super-huit ! Les quelques dizaines de villageois qui peuplaient Ouchgouli avaient mis tellement de cœur dans ce film, qu’ils avaient réussi à lui faire faire le tour du monde, ce qui ne manquait pas de m’émouvoir.
Le même soir, je dormis dans une tour tenue par une femme généreuse qui adorait tellement la France qu’elle me logea gratuitement dans son gite ! Madame Tchelidze était une femme courageuse qui avait totalement sa place dans ces impitoyables montagnes du Caucase, et pour cause : chaque soir, elle repoussait les chiens sauvages les plus agressifs à l’aide d’une pelle plus grande qu’elle (!), provoquant moult couinements effrayés. Elle avait sûrement transmis son tempérament de guerrière à son fils, Luka Tchelidze, joueur de rugby à… Toulon, d’où l’amour de Madame Tchelidze pour la France. Chaque jour, le rituel était immuable : les chiens sauvages sautaient sur la table des touristes allemandes apeurées, tentant de leur voler de la viande. Pour ne pas perdre la face devant elles, Madame Tchelidze souriait en soupirant un vague « oh non ! » de surprise pour la forme, comme si cet incident survenait pour la première fois, avant d’intervenir avec le premier objet qui lui passait sous la main, suscitant la terreur des molosses qui auraient pu ne faire qu’une bouchée d’elle. J’imaginais un nouveau jeu mental : essayer de deviner quelle « arme » Madame Tchelidze allait utiliser chaque nouveau jour de la semaine pour repousser les chiens… J’espère qu’elle recevra mon exemplaire des pirates de l’Escroc-Griffe, que je lui ai envoyé par la Poste.
Si je m’étais écouté, je serais resté une éternité à Ouchgouli, juste pour photographier cette magnifique grand-mère au visage de gitane qui esquissait un sourire enfantin ou ces enfants indomptables à l’allure sévère qui montaient à cheval comme des Kazakhs.

Un matin, je quittais à regret Madame Tchelidze, ses chiens sauvages et le petit monde perdu d’Ouchgouli, coincé dans une bulle temporelle. Je traversais une dernière fois le Grand Caucase, sans imaginer que j’allais découvrir un paysage flamboyant, ce lac turquoise cerné par les montagnes, le lac Inngouri.
Doucement, j’appris à aimer la Svanétie, et ses habitants, des gens froids au premier abord, mais authentiques. Chaque soir, les chants géorgiens me bouleversaient, car par-delà la barrière de la langue, mon cœur écoutait des histoires aussi ancestrales qu’universelles.
Et que dire de l’architecture ? Il faudrait cent articles comme celui-ci pour rendre hommage à la majestueuse forteresse des templiers de Gori, à la magnificence de la cathédrale de Kutaïsi, aux délires urbains de Batoumi, sans parler de Borjomi…
En arrivant en Géorgie, j’avais le sentiment que ce voyage serait déroutant jusqu’au bout… et ce fut le cas. À Tbilissi, le dernier chauffeur que je devais rencontrer, celui qui devait me conduire à l’aéroport, sortit de sa voiture pour ouvrir le coffre. Je m’aperçus alors qu’il n’avait… qu’un bras. Bien sûr, il se révéla être, de loin, le meilleur conducteur du séjour. J’étais définitivement dans un film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. Arrivé à l’aéroport, je repensais à mon grand-père, à Lermontov, et à son roman fétiche, Un héros de notre temps. Quelque chose continuait de m’intriguer. Après une recherche sur mon smartphone, je retins mon souffle : Lermontov était surnommé… « le poète du Caucase ». Il avait en effet grandi dans ces montagnes pour, plus tard, y revenir en qualité d’exilé. Par la suite, Lermontov avait à nouveau rejoint le Caucase, participé à la guerre, avant de trouver la mort dans cette région qu’il connaissait si bien, lors d’un duel. Voilà pourquoi j’avais cette impression que mon grand-père, décédé avant que je ne sois publié, aurait été ravi que j’accomplisse ce voyage… C’était la plus belle façon de découvrir ce Lermontov qu’il aimait tant.
La boucle était bouclée.
De retour en France, mon médecin me révéla que je n’avais pas contacté le paludisme, seulement une bactérie qui fut éliminée en six jours par un traitement médicamenteux, tandis que je passais mes journées à dormir.
Avec le recul, ce voyage m’a profondément changé : je n’ai plus peur des chiens lors de mes promenades… ni de la circulation sur la route. Lors d’une balade en forêt, j’ai attendu le coucher de soleil pour prendre une photo des romantiques étangs du Weirherchen, sans craindre la tombée de la nuit, et j’ai emprunté le chemin du retour dans le noir. Après l’expérience du Caucase, que pouvait-il m’arriver ? Avant ce voyage, je prenais le bus ou le train pour aller de Hettange-Grande à Thionville, or samedi dernier, pour me rendre à la dédicace d’Anaïs Hector, une amie autrice, j’ai accompli ce trajet d’une dizaine de kilomètres à pied, aller-retour, sans sourciller. Je suis désormais capable de marcher en forêt quotidiennement 20 kilomètres par jour, un objectif que je devais seulement atteindre l’année prochaine, je suis en avance sur mon programme.
J’ai surtout compris que le voyage constitue une puissante source d’inspiration. Dès que les frontières asiatiques seront de nouveau ouvertes en 2022, je reprendrai mon sac à dos pour effectuer un périple, voire deux si j’ai de la chance.
- Un voyage dans le désert du Taklamakan, en Chine, à Dunhuang, afin de visiter les fabuleuses grottes de Mogao, grottes qui tiennent un rôle important dans le nouveau roman sur lequel je travaille : à l’intérieur a été retrouvée la version orientale de la bibliothèque d’Alexandrie.
- Le fameux pèlerinage de deux mois au Japon dont je vous avais parlé dans mon article précédent.
En attendant, je dois bien avouer que parfois mon esprit erre en Géorgie, au milieu des montagnes sauvages, à la recherche de ce lac magique tout droit sorti d’un songe de Lermontov.
Turquoise Caucase
Mon petit coin de paradis
Havre des rêves enfouis

Pour Damien, à qui je dois tout. Merci mon ami.