Il n’y aura pas d’article ce vendredi car je serai à Epinal. J’espère vous y voir en chair et en os ! Je porterai cette besace reçue pour mon anniversaire… À très vite !
Il n’y aura pas d’article ce vendredi car je serai à Epinal. J’espère vous y voir en chair et en os ! Je porterai cette besace reçue pour mon anniversaire… À très vite !
Dans cet article je parlais du Japon, un pays qui m’a profondément marqué, et pas seulement au niveau de l’écriture. En 1999, j’ai aussi eu la chance de découvrir une autre contrée hors-normes, la Jordanie, dans le cadre d’une campagne de fouilles archéologiques organisée par le C.N.R.S. et l’I.F.A.P.O. Cette belle aventure, je la dois à un homme, le professeur François Villeneuve, de l’École Normale Supérieure. Alors que je n’étais encore qu’un étudiant en Histoire de 22 ans, il eut la gentillesse de me recruter dans son équipe afin de fouiller l’antique temple nabatéen de Khirbet Edh Dharih… en plein mois de juillet ! Nous étions logés dans l’école désaffectée d’un petit village. Tous les jours, nous nous levions à 5h00 du matin pour prendre les land rovers et profiter au maximum de la fraicheur.
La nuit, il faisait si froid que nous dormions souvent avec des pulls, mais la journée, la température dépassait facilement les 35 °C… Dans ces conditions, nous en étions réduits à effectuer des fouilles seulement la matinée. À dix heures, nous faisions une pause pour manger de la pastèque et boire (le « fatour ») car nous travaillions dans un environnement aride, pour ne pas dire désertique : il n’était pas rare de tomber sur un scorpion, et cette année-là ce fut un collègue archéologue qui en fit les frais avec une piqûre au doigt.
Parfois, la soif était si terrible que déglutir devenait douloureux, mais nous étions tous motivés à l’idée de fouiller le temple d’un peuple fascinant : les Nabatéens. À la manière des Japonais, les Nabatéens furent influencés par les peuples qui les entouraient tout en conservant une culture originale. On retrouve dans leur architecture une influence arabe, égyptienne et grecque… Pas étonnant que nous ayons découvert cette méduse !
C’est lors d’une visite à Pétra que j’ai pris la mesure de cette architecture monumentale. Pour atteindre cette île du désert, il faut traverser le Wadi Rum, pénétrer dans une région montagneuse via un défilé très étroit, le Sîq. Et là, soudain, le Kahzneh s’offre à vous : un mausolée de 43 mètres de haut. C’est Pétra qui m’a inspiré une île des Mers Turquoises dotée de canyons : Perdition.
Ensuite, on monte près de 800 marches…
… et après cette ascension on découvre l’El Deir (« le monastère ») et ses chapiteaux ioniques, un monument qui serait dédié au roi divinisé Obodas Ier. Devenu monastère chrétien au quatrième siècle après J.C., l’El Deir a conservé son urne funéraire à son sommet. Cet édifice m’a inspiré la forteresse de Perdition, construite sur les ruines d’une civilisation mystérieuse…
Ces fouilles archéologiques ont aussi été pour moi l’occasion de rencontrer un peuple accueillant, dans des conditions privilégiées. Je repense parfois à ce guide de Pétra qui n’avait jamais vu la mer, et qui me racontait avec gravité qu’il descendait des Nabatéens. Ou cette nuit passée dans le désert du Wadi Rum, à dormir à moitié enterré dans le sable sous une infinité d’étoiles. Et ce silence… Deux jours plus tard, je revenais en France sous la pluie avec une dizaine de kilos en moins, et une violente angine. En sortant de l’aéroport de Nice, je sentais l’humidité dans l’air tout autour de moi, avec l’impression que les gens étaient littéralement gorgés d’eau. Alors que les arrosages automatiques se lançaient sous la pluie, j’étais émerveillé par cette richesse qui m’entourait, et horrifié par le gaspillage. Pour la première fois de ma vie, je réalisais la chance que j’avais de vivre dans un pays riche en eau.
En regardant ces photos, je ne peux m’empêcher de ressentir de la nostalgie. Du haut de mes 22 ans, j’étais emprunt d’une certaine innocence : dans ce monde pré-11 septembre, l’Irak et la Syrie n’étaient pas en guerre, et il était encore possible de visiter le souk d’Alep, les bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan… J’avais la naïveté de penser que ces trésors archéologiques seraient toujours à l’abris de la folie des hommes. Mais tous ces drames n’effaceront jamais mes convictions humanistes, au cœur des Pirates de l’Escroc-Griffe.
Pour en savoir plus sur cette campagne de fouilles, ça se passe ici.
La semaine dernière, je vous ai proposé un article assez délirant (mais pas tant que ça) sur la théorie scientifique d’un univers vivant, mais faute de place, je ne vous ai pas parlé d’un animal qui me passionne, le tardigrade. Je suis tellement fan de ce « marcheur lent » (du latin tardigradus) qu’en 2009 j’ai même acheté un microscope pour l’étudier ! Et je n’ai pas pu m’empêcher d’en caser un dans le tome 3 des Pirates de l’Escroc-Griffe… Bon, quel rapport avec mon billet précédent ?
À la fin des années 90, je suis tombé sur un article scientifique hallucinant : des chercheurs ont extrait par hasard de la glace des tardigrades congelés surnommés «oursons d’eau», des animaux à huit pattes qui mesurent jusqu’à 1,5 millimètres de diamètre. Les scientifiques étaient persuadés qu’ils étaient morts, mais à leur grande surprise, les tardigrades ont repris vie après un long sommeil ! En cas de stress physique, ces petites bêtes qui ne vivent habituellement que quelques mois rentrent en cryptobiose : elles rétractent leurs huit pattes pour perdre 99% de leur eau, et la remplacent par un antigel de synthèse. Dans cet état, même avec des capteurs ultra-sophistiqués, il est impossible de déterminer si ces créatures sont vivantes ou mortes !
Les tardigrades sont omniprésents : on les trouve dans les mousses et lichens de nos forêts, au sommet de l’Himalaya, dans les régions polaires, et même dans les océans à 4000 mètres de profondeur ! Il faut dire que ces bestioles disposent de propriétés étonnantes. Elles peuvent encaisser des doses de rayons X mortelles pour l’homme, résister à une température de -272°C (un degré du zéro absolu), ou de 150 ° pendant quelques minutes. Plus incroyable encore, les oursons d’eau peuvent supporter 60.000 mètres de fond ! Étrange quand on sait que la fosse des Mariannes, le point le plus profond de la planète, fait « seulement » 11.000 mètres de profondeur… Pourquoi ces animaux sont-ils suradaptés à notre environnement ? En 2007, je n’étais pas au bout de mes surprises : cette année-là, une fusée russe a emmené dans l’espace des tardigrades pendant 12 jours. À ma grande stupéfaction, la plupart des « marcheurs lents » ont résisté au vide. Malgré les rayonnements ultra-violets, connus pour abimer les chromosomes, les tardigrades survivants ont pu se reproduire à leur retour, ce qui laisse entendre que ces créatures répareraient leur ADN !
Pour résumer, ces animaux sont capables de survivre dans le vide spatial, de supporter des pressions et des températures inconnues sur Terre, ont résisté à cinq extinctions majeures d’espèces sur plusieurs centaines de millions d’années, ainsi qu’à bien d’autres environnements extrêmes… Ces organismes suradaptés ont-ils voyagé dans des météorites avant d’atteindre notre belle planète bleue ? La panspermie est-elle possible ? L’éternel rêveur que je suis n’a pu s’empêcher de songer à ces questions, sans imaginer un seul instant que des biologistes américains et russes allaient se pencher dessus également ! Le but de la mission LIFE (Living Interplanetary Flight Experiment) était d’envoyer durant trois ans dans l’espace des organismes extremophiles tels que des bactéries, des mousses, et des tardigrades. Le voyage devait les amener jusqu’à la lune martienne de Phobos, avant leur retour sur Terre. Malheureusement, le module s’est écrasé dans l’océan Pacifique.
Il y a fort à parier que dans les années à venir, d’autres tardigrades seront envoyés dans l’espace. Peut-être qu’un jour les scientifiques arriveront à prouver que la vie dans l’univers est un phénomène courant, sinon banal…
EDIT : il y a peut-être des milliers de tardigrades en vie sur la Lune
Suite à une conversation avec un ami sur l’univers, j’ai pensé à cette allégorie poético-scientifique.
Prenons l’un des plus petits êtres vivants connus sur Terre, une ultramicrobactérie de 0,3 micromètres de diamètre capable de vivre dans de l’eau salée. Imaginons que cette minuscule bactérie soit, miracle ! dotée d’une conscience et de sens. Elle évolue dans la mer et, comme la plupart des ultramicrobactéries, ne grandit, ni ne se reproduit, pour résister à des conditions difficiles. Imaginons maintenant qu’elle soit avalée par une baleine bleue de 30 mètres de long, puis recrachée. Notre bactérie en aurait-elle seulement conscience ? On peut en douter car, comme elle mesure 0,3 micromètres, une goutte d’eau d’1 millimètre de long serait déjà pour elle un vaste territoire de 1000 micromètres. Alors comment pourrait-elle se représenter un organisme aussi complexe que l’intérieur d’une baleine ? Là encore, notre ultramicrobactérie devrait mesurer l’univers à partir de sa taille, 0,3 micromètres. Pour elle, le cétacé ferait donc 30 millions de micromètres. Cela reviendrait, pour un humain d’1,80 mètres, à imaginer devant lui un géant d’une hauteur de 180.000 kilomètres, presque la moitié de la distance Terre-Lune. À notre échelle, le doigt de pied de ce géant serait aussi grand qu’une montagne qui disparaitrait dans les nuages, au point où nous refuserions d’admettre que nous sommes en présence d’un être vivant, capable de nous avaler sans même s’en apercevoir ! Ce qui est farfelu pour nous le serait tout autant pour notre micro-organisme, qui tenterait d’imaginer dans quoi pourrait bien nager une baleine… Comment notre bactérie pourrait-elle se représenter plus d’un milliard de km3 de mers et d’océans ?
De notre point de vue, nous avons du mal à réaliser que deux êtres vivants aussi dissemblables qu’une bactérie et une baleine possèdent de l’ADN de la taille d’une molécule… alors que ces deux êtres n’ont pas grand chose en commun. Et pourtant, la vie et la mort de l’un peut conditionner étroitement l’existence de l’autre sans que les deux en aient « conscience ». Ainsi, dans les profondeurs des mers, des bactéries se développent sur des os de baleines. Dans ce milieu, à mesure que l’oxygène se raréfie, les bactéries provoquent une augmentation du sulfure et l’arrivée d’espèces qui vivent en symbiose. Les bactéries sur les os utilisent comme source d’énergie le sulfure d’hydrogène produit par d’autres bactéries qui s’attaquent à l’intérieur de l’os. C’est le début d’une chaîne alimentaire spécifique aux abysses, la chimiosynthèse. À l’échelle d’une bactérie à la durée de vie limitée, un os de baleine est un univers infini qui n’a ni début ni fin.
À notre propre échelle, nous n’avons pas conscience que les bactéries qui vivent à l’intérieur de nos intestins ont un rôle bénéfique. Et là encore, si ces bactéries étaient dotées de conscience, il serait difficile pour elles de concevoir une telle symbiose. À une échelle encore plus grande, qui nous dit que l’univers ne serait pas un système biologique, un réseau inconcevable pour les pauvres bactéries que nous sommes ? Détail amusant, au niveau macroscopique on trouve dans l’univers des objets fractals aux formes similaires à celle de l’ADN ou d’un coquillage, ce sont les galaxies :
Puisqu’on parle de réseau et de cosmos, il est intéressant de constater que les galaxies se groupent en amas. Les scientifiques admettent que notre Voie lactée et la galaxie d’Andromède sont liées gravitationnellement, comme bon nombre de galaxies. Au début de l’année, des astronomes ont enfin pu photographier une partie de ce réseau, de l’hydrogène illuminé par un quasar, et ainsi détecter une gigantesque nébuleuse de gaz et de poussières d’environ deux millions d’années-lumière de diamètre. Bien qu’ils soient totalement différents, le cerveau humain et un superamas de galaxies sont des systèmes d’une complexité inouïe.
Comparer un réseau neuronal avec l’univers connu serait bien sûr faire preuve de réductionnisme tant ces deux systèmes n’ont rien en commun. Mais l’idée de réseau est étroitement associée à la notion d’organisation, de complexité… et donc de sophistication. Ce qui est ironique, c’est que nous étudions bon nombre de réseaux autour de nous, mais que nous avons toujours le plus grand mal à définir ce qu’est « la vie ». Au niveau microscopique, les biologistes ne considèrent pas les virus comme des êtres vivants, mais les classent dans la catégorie des « entités biologiques ». Qui nous dit que l’univers connu n’est pas la minuscule brique d’un organisme vivant bien plus complexe que tout ce que nous pourrions imaginer ? Cela pourrait apporter une réponse au mystère du principe anthropique : certains scientifiques, religieux et philosophes estiment que l’univers comporte tellement de paramètres précis pour que la vie soit possible, que ce même univers a forcément été créé pour que l’homme soit au sommet de cette pyramide de la complexité. Mais avec la théorie d’un univers vivant, l’explication serait beaucoup plus simple : la vie serait…. banale, et l’homme un maillon de l’évolution, au même titre qu’un virus.
Si dans les siècles ou millénaires à venir, cette hypothèse farfelue venait à être confirmée, ce serait à nouveau une terrible blessure narcissique pour les bactéries l’Humanité.
Bonus : l’épisode « L’univers est-il vivant ? » de la série scientifique « Voyage dans l’espace-temps » de Science Channel, présenté et produit par Morgan Freeman, qui propose plusieurs théories d’astrophysiciens et de biologistes.
Il y a quelque temps j’ai lu deux livres passionnants qui ont bouleversé mes certitudes. En tant que littéraire, j’ai toujours été interpelé par ce précepte humaniste de Rabelais : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme ». J’ai suivi un enseignement chrétien, mais je nourris une profonde admiration pour les chercheurs, qu’ils soient physiciens ou mathématiciens. À mon humble niveau, l’histoire et la philosophie m’ont permis d’étudier les sciences et la religion. J’expliquais dans cet article que depuis quelques années, j’avais le pressentiment que la physique allait peut-être redevenir une métaphysique qui modifierait la frontière entre science et spiritualité. Depuis presque un siècle, les physiciens de la mécanique quantique ont découvert qu’à l’échelle des particules, non seulement le temps n’a plus aucun sens, mais qu’en plus la perception d’une expérience influe directement sur son déroulement : en effet, pour observer des particules, il faut de la lumière, et donc des photons… Le grand Albert Einstein lui-même s’est disputé avec Niels Borh à ce sujet, notamment en ce qui concerne le paradoxe EPR, le fait que la lumière ressemble tantôt à des particules, tantôt à des ondes. Einstein affirmait que la mécanique quantique ne donnait pas une description complète de la réalité, qu’il y avait des « variables cachées ». Albert Einstein avait en fait tort et par la suite, jamais la science n’a pris en défaut cette curieuse mécanique quantique. Je dis bien curieuse, tant les physiciens quantiques eux-mêmes ont été déroutés… pour ne pas dire plus : à l’époque, les gens qui les écoutaient avaient parfois l’impression d’avoir affaire à des illuminés !
Les hippies de la mécanique quantique
Lors d’une dispute mémorable, Albert Einstein dit à Niels Bohr « Dieu ne joue pas aux dés ! ». Bohr répond : « Qui êtes-vous Einstein, pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ! »
 Albert Einstein et Niels Bohr
Albert Einstein et Niels Bohr
Selon Niels Bohr : « notre description de la nature n’a pas pour but de révéler l’essence réelle des phénomènes, mais simplement de découvrir autant que possible les relations entre les nombreux aspects de notre existence ». Son expérience sur le fait que la lumière ressemble tantôt à des particules, tantôt à des ondes, explique son blason mystique inspiré du yin et le yang, avec l’inscription latine contraria sunt complimenta, qui signifie que les contraires sont complémentaires. « Parallèlement aux leçons de la théorie atomique… nous devons nous tourner vers les problèmes épistémologiques auxquels des penseurs comme le Bouddha et Lao-tseu ont déjà été confrontés, en essayant d’harmoniser notre situation de spectateurs et acteurs dans le grand drame de l’existence ».
 Le blason de Bohr
Le blason de Bohr
Vous allez me dire qu’il n’y a rien d’étonnant à ce qu’un scientifique ait des idées bizarres. Mais en réalité, c’était quelque chose de très répandu parmi cette génération de chercheurs. Pour Erwin Schrödinger, qui a entretenu une longue correspondance avec Albert Einstein, « il vaut mieux ne pas regarder une particule comme une entité permanente, mais plutôt comme un événement instantané. Parfois ces événements forment des chaînes qui donnent l’illusion d’être des objets permanents ». Pour lui, « les objets atomiques et subatomiques ne possèdent aucun attribut qui leur soit propre. Quand ils ne sont pas observés, il est impossible, même par la pensée, de leur attribuer une vitesse déterminée et une trajectoire le long de laquelle ils occuperaient à chaque instant un lieu précis. Nous n’avons donc pas le droit de considérer les objets quantiques comme étant constamment doués de propriétés mesurables ». Après son célèbre chat, Schrödinger a par la suite étudié l’hindouisme, qui lui a inspiré la possibilité que notre conscience soit la manifestation d’une conscience globale se répandant dans l’univers…
 Vous ne trouvez pas qu’Erwin Schrödinger aurait fait un très bon Doctor Who ?
Vous ne trouvez pas qu’Erwin Schrödinger aurait fait un très bon Doctor Who ?
Werner Heisenberg, prix Nobel de physique et ami de Niels Bohr, affirme lui aussi qu’en « mécanique quantique la notion de trajectoire n’existe même pas ». Il ne s’agit plus d’étudier un objet, mais un événement donné, qui forme avec les instruments d’observation un tout indivisible. Le but de la physique n’est plus la description de la réalité, mais la description de « l’expérience humaine communicable », c’est-à-dire celle des observations et mesures. Pour Heisenberg, « l’importante contribution du Japon à la théorie de la physique depuis la dernière guerre indique peut-être une certaine parenté entre les idées philosophiques traditionnelles de l’Extrême-Orient et la substance philosophique de la théorie quantique ».
 Niels Bohr et Werner Heisenberg
Niels Bohr et Werner Heisenberg
Une pensée bouddhiste du moine Nagarjuna va dans le sens de ces scientifiques : elle affirme que « plus nous sommes loin du monde, plus il nous parait réel. Plus nous nous en rapprochons, moins il est saisissable, comme un mirage dénué de réalité tangible ». Vous l’aurez deviné, le bouddhisme, c’est précisément le thème du livre le moine et le philosophe que j’ai lu il y a peu, suivi de L’Infini dans la paume de la main, par (coïncidence !) l’un des auteurs de l’Univers élégant, l’astrophysicien Xuan Thuan Trinh. Dans le moine et le philosophe, un père et son fils débattent du sens de la vie : d’un côté, Jean-François Revel, philosophe athé et membre de l’Académie française, de l’autre Matthieu Ricard, un brillant chercheur en biologie qui a abandonné sa carrière pour devenir moine bouddhiste et porte-parole du Dalaï-Lama. Ces deux ouvrages sont surprenants à plus d’un titre. On s’attend à un débat classique entre un partisan de la science et un adepte de la religion, mais en réalité on découvre que le bouddhisme est une science contemplative, une philosophie rigoureuse qui dispose d’une logique : la vérification par l’expérience directe, la déduction irréfutable et le témoignage digne de confiance.
Ce qui m’a fasciné, c’est la différence culturelle entre l’Asie et l’Occident. Depuis la Grèce antique, notre civilisation a consacré l’essentiel de ses ressources intellectuelles à élaborer une science technique lui permettant de maîtriser la Nature, alors que l’Asie s’est focalisée sur une science contemplative visant à éveiller l’homme dans son cheminement intérieur, suivant ainsi une toute autre voie. Du coup, le bouddhisme est une sagesse d’une pertinence inouïe : grâce à 2500 ans de recherches continues, ses adeptes tentent via la connaissance d’échapper aux souffrances de l’existence, et développent des valeurs telles que la compassion. Le bouddhisme amène également une autre approche de la réalité, qui rejoint de manière frappante les physiciens de la mécanique quantique.
Interdépendance et indépendance
Pour les bouddhistes, il y a un lien entre tout : c’est « l’interdépendance », un vaste flux d’événements reliés les uns aux autres. À la manière des physiciens de la mécanique quantique, et de certains philosophes grecs, les bouddhistes ne croient pas qu’il y ait d’entités permanentes dans l’univers. De la même façon, ils réfutent également l’idée d’un dieu tout-puissant. Soit le créateur ne décide pas de créer, et alors il n’est pas tout puissant car la création s’est fait en dehors de sa volonté, soit il créé volontairement et il n’est pas non plus tout-puissant puisqu’il créé sous l’influence de son désir de créer. Un créateur ne peut être une entité permanente car il est différent avant et après avoir créé. Il devient en effet « celui qui a créé ». De plus, une « entité » réellement existante ne saurait naître ni disparaître : l’être ne peut naître ni du néant, car une infinité de causes ne sauraient faire venir à l’existence ce qui n’existe pas, ni de ce qui existerait déjà, car alors il n’aurait pas besoin de naître. Soit la cause disparait avant l’effet, soit la cause subsiste au moment de l’effet, ce qui interdit toute causalité dans la simultanéité. À notre échelle, on a une impression de cause à effet. La cause et l’effet coexistent comme la lumière du soleil et la plante qui l’absorbe, mais en réalité les rayons du soleil qui permettent à la plante de germer ne sont pas les mêmes que les rayons qui la chauffent par la suite.
Pour les bouddhistes, il n’y a pas d’entités indépendantes : de la même façon qu’une flamme n’existe que parce qu’elle est constituée des particules qui changent constamment dans des conditions données précises, c’est uniquement en relation et en dépendance avec d’autres facteurs qu’un événement peut survenir. L’interdépendance est synonyme de « vacuité », un terme qui ne remet pas en cause les phénomènes qui nous entourent, mais l’absence d’entités autonomes formant la réalité. On peut très bien faire l’expérience d’un phénomène sans lui allouer une existence propre, c’est le cas d’un arc-en-ciel. Une rivière ne peut pas être faite d’une seule goutte, une charpente d’une seule poutre : il est impossible qu’une chose existe ou naisse par elle-même. Ce qui explique, d’une certaine manière, le fait que l’ordinateur sur lequel je suis en train d’écrire cet article n’existe pas à proprement parler, il n’est qu’un assemblage d’événements reliés les uns aux autres.
Une troisième voie
Au-delà des points communs avec la physique quantique, j’ai été fasciné par l’idée d’une « troisième voie » entre la science et la religion : il n’y aurait pas de réalité cachée comme peuvent l’imaginer les scientifiques, de paradis chrétien, ou de monde platonicien des idées, mais pas non plus de réalité tangible telle qu’on la conçoit dans la vie de tous les jours. Dans cet article, j’expliquais que le physicien Brian Greene évoquait la théorie d’un univers mathématiques, puisqu’elles sont omniprésentes autour de nous. Le bouddhisme pourrait être la preuve définitive, et somme toute logique, que les mathématiques sont un produit de notre esprit, au point où nous les voyons partout. Cela expliquerait également pourquoi le temps n’a guère de sens en mécanique quantique. Nous vivrions dans un monde d’illusions qui n’existerait que par des liens d’interdépendance, aussi notre souffrance viendrait de notre insatisfaction. Il n’y aurait pas de condamnation et de châtiment, de Bien et de Mal, seulement le bien et le mal que nos actes engendrent : la priorité du bouddhiste est donc de se consacrer à l’essentiel, et de devenir un homme meilleur. Si la science contemplative qu’est le bouddhisme échappe par certains aspects à une démarche rationnelle telle que l’affectionne l’Occident (comment prouver scientifiquement que le bouddhisme est spirituellement bénéfique ?), l’enseignement du Bouddha n’est pas pour autant un dogme. Pour ma part, j’ai été impressionné par le fait que cette philosophie religieuse, ou religion philosophique, est avant tout une sagesse qui a fait ses preuves, comme j’ai pu moi-même le constater au Japon dans les temples zen : que vous soyez athée ou chrétien, les moines vous accueillent avec le sourire, vous laissent participer à leurs rites, et ne pratiquent aucun prosélythisme.
 Ma photo des pétales de lotus du piédestal du Grand Bouddha de Nara. Les sept paires de pétales montrent une infinité d’univers. L’œuvre dans son ensemble ne représente pas des individualités, mais leur interdépendance
Ma photo des pétales de lotus du piédestal du Grand Bouddha de Nara. Les sept paires de pétales montrent une infinité d’univers. L’œuvre dans son ensemble ne représente pas des individualités, mais leur interdépendanceDans un article de l’Express, le moine Matthieu Ricard expliquait qu’en découvrant des grands maîtres tibétains fuyant l’invasion chinoise, il avait l’impression de rencontrer « 20 saints François d’Assise vivants ». Sans tomber dans l’angélisme, j’ai le sentiment que le catholicisme donne un modèle christique en fournissant une carte pour s’orienter, tandis que le bouddhisme serait plus un guide de voyage pour avancer jusqu’où bon nous semble dans notre propre cheminement intérieur.
« Se transformer soi-même avant de transformer le monde »
Si, depuis des millénaires, une multitude d’hommes et de femmes ordinaires réussissent à atteindre de manière non violente un certain degré de sérénité et de bonheur, et font preuve d’humanité et de compassion à l’égard des plus démunis, peut-être que notre propre civilisation doit reconsidérer ses priorités en matière d’éducation, d’écologie, d’éthique, voir même de spiritualité laïque puisque les religions n’ont pas le monopole du cœur. Plongé dans un scientisme effréné, l’Occident a oublié ses racines et ses richesses : la sagesse des philosophes grecs, l’idéal humaniste de la Renaissance. Pendant des années j’étais persuadé que l’Humanité était vouée à réconcilier foi et raison, mais jamais je n’ai pensé à une troisième voie entre science et spiritualité. Albert Einstein disait « la religion du futur sera une religion cosmique. Elle devra transcender l’idée d’un Dieu existant en personne et éviter le dogme et la théologie. Couvrant aussi bien le naturel que le spirituel, elle devra se baser sur un sens religieux né de l’expérience de toutes les choses, naturelles et spirituelles, considérées comme un ensemble sensé. Le bouddhisme répond à cette description… S’il existe une religion qui pourrait être en accord avec les impératifs de la science moderne, c’est le bouddhisme ».
Je suis vraiment d’accord avec cette analyse.
Depuis le triomphe du Seigneur des Anneaux, d’Harry Potter et de Twilight (snif), on nous répète régulièrement que la Science-Fiction est moribonde, aussi bien dans la littérature qu’au cinéma. La télévision ne semble guère prêter une confiance démesurée au genre : le succès de BattleStar Galactica en 2003 n’a pas empêché, par la suite, la disparition de nombreuses séries cultes comme Star Trek: Enterprise, Firefly ou Stargate. L’auteur de hard science Kim Stanley Robinson a même déclaré que le space opera, sous-genre emblématique de la SF, doit mourir ! Alors qu’aujourd’hui le steampunk et la bit-lit ont le vent en poupe, comment expliquer le manque de SF dans le catalogue des éditeurs ? Le succès d’Avatar n’est-il qu’un leurre ?
On n’écrit plus de la SF comme dans les années 60-70
Dune, La Guerre des Étoiles, 2001 : l’Odyssée de l’espace… autant de romans et/ou de films qui ont marqué leur époque, comme dirait Captain Obvious. Mais ne devrait-on pas plutôt écrire que ces oeuvres sont révélatrices d’une période ? Dune a été publié en 1963, 2001 en 1968, tandis que le premier scénario de Star Wars a été écrit en 1973, à un moment où les lecteurs et les spectateurs étaient en manque d’épopées : le western hollywoodien avait quasiment disparu des écrans. Parallèlement, il y avait un réel besoin de spiritualité de l’Occident, de plus en plus attiré par le bouddhisme oriental. Pas étonnant que les œuvres mystiques de Franck Herbert, Arthur C. Clarke et George Lucas aient triomphé à cette époque. Quelques années plus tard, Alien, Blade Runner et Mad Max cristallisent le désenchantement de la génération no future, frappée par la crise. Ces chef-d’oeuvres offrent une vision pessimiste de l’avenir, qui s’accentuera dans les années 80 avec Terminator, la Mouche, RoboCop, New York 1997, les romans cyberpunks des années 80 de William Gibson ainsi que la Stratégie Ender. À partir des années 90, les auteurs de Science-Fiction rencontrent un paradoxe : bien que la technologie n’ait pas évolué aussi vite que ce qui avait été prédit par les romanciers de l’âge d’or de la SF, notre société est bouleversée par des progrès techniques sans précédent tels que les organismes génétiquement modifiés, Internet, la téléphonie mobile…

Superordinateur Blue Gene participant au programme Blue Brain, visant à modéliser un cerveau synthétique
Du coup, difficile pour un auteur de se projeter dans un lointain futur alors qu’il ne se passe pas une année sans qu’un nouvel objet change notre quotidien, pour le meilleur, mais aussi pour le pire : cela explique en partie pourquoi, depuis les années 90, les spectateurs et les lecteurs plébiscitent de plus en plus les dystopies se déroulant dans des futurs proches telles que Bienvenue à Gatacca ou Hunger Games.
Si la technologie est devenue extrêmement complexe, cela signifie-t-il que l’auteur de SF, noyé sous l’information, a du mal à imaginer l’avenir ? Je pense qu’en réalité le problème est pris à l’envers : je sais que c’est facile à dire, mais pour moi un écrivain de Science-Fiction ne devrait jamais se retrouver dans cette position inconfortable.
Ecrire de la SF, c’est s’intéresser à la technologie… toute la technologie
Attention, je ne suis pas en train d’affirmer que la SF d’aujourd’hui appartient uniquement aux technophiles comme Greg Egan, ou à des ingénieurs. D’ailleurs, je ne suis moi-même qu’un littéraire, un scribouillard qui papillonne autour des sciences comme un papillon près d’une lampe. Mais comme je l’écrivais dans cet article, l’Humanité est sur le point de connaître une révolution scientifique. Alors que pendant près de deux mille ans les questions d’ordre cosmologique ont été réservées aux théologiens, les chercheurs sont en train d’exaucer le rêve des penseurs grecs de l’Antiquité : comprendre la nature intime de l’Univers. Les physiciens sont désormais les nouveaux philosophes d’un monde moderne en plein bouleversement. Du coup, un romancier peu porté sur la technologie se retrouve dans la position d’un humaniste de la Renaissance qui ne s’intéresserait pas au développement des arts et des sciences ! Je pense que c’est la même difficulté que rencontrent parfois les scénaristes de mauvais James Bond, vous savez, ceux dans lesquels les gadgets manquent d’originalité. Inversement, les auteurs de la série Star Trek : The Next Generation m’impressionnent, car durant les années 90 ils s’inspiraient en permanence des découvertes scientifiques pour écrire des épisodes mémorables. L’actualité, c’est le terreau de l’imaginaire, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment elle est fertile. Preuve en est avec l’année 2014, hallucinante à plus d’un titre : dans les mois à venir, la NASA va tenter (entre autre) de détecter les « points X », d’éphémères portails invisibles reliant le champ magnétique du Soleil à celui de la Terre, grâce au programme spatial Magnetospheric Multiscale Mission (M.M.M.).
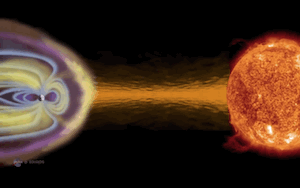
Un GIF conçu par votre serviteur représentant les champs magnétiques de la Terre et du Soleil en train de se connecter
Tout aussi incroyable, depuis deux ans des scientifiques téléportent de l’information quantique sur près de 150 kilomètres via des photons, posant les bases d’une possible nouvelle forme de communication avec nos satellites spatiaux.
Le monde change… y compris dans notre quotidien. Si Edgar Rice Burroughs était encore de ce monde, il décrirait probablement une Mars très différente de celle que John Carter découvre en 1917. Or les cinéastes et les romanciers ont trop souvent eu tendance à recycler Ridley Scott et Philip K Dick, comme si Blade Runner et Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? constituaient des références indépassables.
Le cyberpunk est mort… vive le biopunk
Ou du moins, il y a une vie après le cyberpunk. Bien que j’adore Neuromancien, Tron et Matrix, il ne faut pas oublier que ces oeuvres ont été créées, là encore, dans un contexte particulier, celui de l’émergence du numérique. Aujourd’hui, il y a d’autres frontières à explorer, notamment depuis que les briques du vivant sont brevetées par de puissantes multinationales. De la même façon que les hackers de l’open source se sont opposés à l’informatique de Microsoft, on a désormais des biohackers en rupture avec la politique de Monsanto, les dignes enfants (terribles) des cyberpunks des années 80. À San Francisco, ils fabriquent des incubateurs, se réunissent dans des garages pour vérifier la qualité d’un aliment, ou détecter la présence d’OGM dans leur nourriture. Qu’ils soient biologistes ou autodidactes, tous s’amusent à la façon des hackers informatiques : ils extraient de l’ADN de leur salive pour l’étudier et le dupliquer grâce à un thermocycleur à 60 dollars, modifient une bactérie dans un incubateur de fortune ou commandent de l’ADN via Internet pour recevoir la séquence par la Poste ! La totalité du génome humain tient dans un fichier d’1,44 Go, exploitable sur n’importe quel ordinateur, ce qui permet de découvrir si on est prédisposés à certaines maladies, comme dans cet hackerspace de Los Angeles.
On retrouve cette culture du bidouillage à Paris, avec l’association la Paillasse, logée en région parisienne au fond d’une cave sous la végétation.
Cette équipe rassemble des étudiants, des scientifiques ou des bricoleurs. Des idéalistes adeptes de l’open source qui militent pour que les gènes ne soient pas privatisés par les brevets des multinationales, mais aussi de simples curieux qui s’amusent à extraire l’ADN d’une plante. Les cyberpunks ont popularisé le langage informatique, les biohackers manipulent le langage génétique, un curieux assemblage des lettres A, T, G et C. Bien que le droit français leur interdit de modifier le génome d’humains, d’animaux ou de végétaux, ils ont la possibilité de créer des bactéries pour imaginer les inventions de demain : un bio-détecteur qui deviendra rouge en présence de matériaux toxiques, de mines anti-personnels ou de tumeurs cancéreuses, un purificateur d’eau bon marché pour des villageois indiens, du carburant propre…
Des étudiants ont ainsi créé une bactérie qu’on injecte dans la fissure d’un mur : lorsque la paroi se craquelle, on réinjecte du sucre pour la renforcer. Dans un autre domaine, un bio-senseur a été inventé pour détecter l’arsenic dans les puits du Bangladesh. Prix : un dollar ! Une équipe a même élaboré des bactéries capables de sentir les molécules d’une viande avariée et de donner l’alerte via une protéine phosphorescente.
Bien évidemment, dans les pays anglo-saxons, beaucoup plus permissifs que la France, les dérives transhumanistes ne peuvent être exclues : il n’est pas impossible qu’à l’avenir apparaissent des bio-tatouages ou de marqueurs corporels capables d’afficher sur la peau des constantes vitales fluorescentes. Nous vivons à la fois dans un monde passionnant et anxiogène, une source d’inspiration illimitée pour un écrivain comme Greg Egan. À l’heure où j’écris ces lignes, il est possible de construire un pistolet via une imprimante 3D, ou bien les matériaux d’une maison. Mais demain, il est fort probable que nous pourrons imprimer de la drogue des médicaments. Optimiste ou carrément cauchemardesque, la Science-Fiction a encore de beaux jours devant elle… à condition qu’on s’intéresse au monde d’aujourd’hui.
P.S. : pour en savoir plus, je ne saurais trop vous conseiller ce fabuleux documentaire interactif du Monde.fr sur les biohackers, très objectif, un documentaire fascinant qui m’a inspiré dans la rédaction de cet article.
J’ai lu en deux heures l’excellent bouquin d’Andrew Richard Albanese : 9,99$, La Guerre du livre numérique. Il faut dire que le geek que je suis était particulièrement concerné par le sujet : j’ai acheté l’iPad dès sa sortie en 2010, et plus tard j’ai basculé du côté obscur de la Force avec un Kindle, sans pour autant renier l’iPad, qui me sert à lire des comics en couleurs. Andrew Richard Albanese a parfaitement résumé la courte (mais tumultueuse) histoire de l’ebook. Depuis 2010, ce ne sont pas quatre années, mais plutôt quatre siècles qui se sont écoulés ! Les liseuses, les tablettes et les smartphones sont partout. Et pourtant en France, le marché des livres numérique se développe lentement. La technologie a beau être mature, le monde de l’édition n’a pas forcément pris la mesure de cette révolution qu’est la dématérialisation, une lame de fond qui a failli emporter l’industrie musicale à la fin des années 90. Le livre d’Albanese se résume à une seule problématique.
Le prix d’un ebook est le nerf de l’éditeur, euh, de la guerre
Alors que le monde du livre connait une crise sans précédent, quel prix faut-il fixer à un ouvrage numérique ? Cette question a priori toute simple a fait couler beaucoup d’encre (et usé pas mal de touches). Je me rappelle encore de ma réaction ahurie lorsque j’ai voulu acheter mon premier ebook.
À la sortie de l’iPad, un Stephen King valait au moins 15 euros ! Les ebooks étaient vendus non pas au prix des livres de poche, mais comme des grands formats… Aujourd’hui la situation a évolué : on peut acquérir sur son iPad ou son Kindle le premier tome du Trône de Fer pour 8,99 euros. C’est un peu plus cher que la version poche (7,70 euros), mais bien moins qu’un grand format (21,19 euros). Alors, quel est le prix idéal d’un ebook ? La question est plus complexe qu’elle en a l’air, car elle concerne la valeur qu’on attribue à un livre. Je reconnais que si les éditeurs s’amusaient à vendre leurs romans 99 centimes, ces ouvrages perdraient beaucoup de valeur. D’ailleurs, combien de gens ont téléchargé gratuitement des livres numériques qu’ils n’ont ensuite jamais lus ?
Le problème, c’est que le lecteur est face à un nouveau paradigme, un peu comme nos ancêtres lorsque l’imprimerie est apparue à la fin du Moyen-Âge. Avant cette invention, chaque livre était un objet d’art unique, mais sa lente conception coûtait horriblement cher. Lorsque Gutenberg a inventé ses célèbres caractères mobiles en plomb, une partie de l’élite intellectuelle a regretté que la culture du manuscrit ait été terrassée par des artisans équipés de presses à imprimer. Avec la désacralisation du livre, l’impensable était pourtant arrivé : acheter un ouvrage n’était plus un luxe réservé à une minorité. Le bénéfice était si immense, qu’à l’exception des moines-copistes, tout le monde était d’accord sur l’idée que cette industrialisation était une évolution nécessaire. Je ne vais pas être hypocrite : si j’avais la possibilité de choisir entre l’ebook de la Vie des douze Césars de Suétone, et une version médiévale écrite sur du parchemin, j’opterais bien évidemment pour le magnifique ouvrage de n’importe quel moine-copiste. Mais qui oserait aujourd’hui soutenir que l’imprimerie de Gutenberg n’a pas été un progrès fondamental pour l’Humanité ? Au fil des siècles, cette désacralisation du livre, qui est avant tout une démocratisation de la culture, n’a cessé de s’accentuer avec, par exemple, la reliure industrielle au XIXe siècle, la naissance du pulp, l’édition de poche au XXe siècle et… l’ebook.
Mais en France, les lecteurs considèrent que cette dématérialisation devrait permettre une baisse de prix beaucoup plus conséquente, c’est d’ailleurs l’un des facteurs qui explique pourquoi le livre numérique s’implante plus lentement dans notre pays.
Un facteur culturel
Le débat fait rage entre les défenseurs du noble objet-livre et les partisans du numérique, accusés de le désacraliser. Ironie du sort, on pourrait intenter le même procès à nos imprimeurs car l’encre de nos livres actuels aura bien du mal à traverser les siècles… contrairement à celle utilisée par les moines-copistes ! Certains rétorqueront, avec raison, qu’il n’est pas impossible qu’au fil des décennies ces fichiers deviennent obsolètes. Pour ces allergiques au numérique, un ebook à 99 centimes sera toujours trop cher, étant donné qu’il n’est pas « garanti à vie ». En y réfléchissant bien, l’argument du manque de fiabilité qui a été reproché au numérique peut se retourner contre le papier, avec des livres susceptibles d’être perdus lors d’une inondation ou durant un déménagement (j’en sais quelque chose, snif). Avec la dématérialisation, et de nouveaux modèles économiques, une telle perte devient virtuellement impossible. C’est là où, à mon humble avis, la polémique du numérique est à côté de la plaque : beaucoup de gens redoutent que ce format ne se substitue au papier, comme jadis l’imprimerie le fit pour le manuscrit. Mais c’est oublier que les deux supports sont complémentaires, et vont encore cohabiter très longtemps. Pourquoi faudrait-il choisir ? On ne le répétera jamais assez, rien ne remplacera un livre papier. Mais à côté de ça, quel bonheur de transporter dans la poche sa bibliothèque idéale à l’autre bout du monde ! De lire durant la nuit dans son lit sans déranger sa moitié ! Et de savoir que même si votre liseuse rend l’âme, tout votre collection est sauvegardée dans le cloud.
Le numérique amène de nouveaux paradigmes comme Youbox, le « Spotify » de l’ebook. Un autre modèle économique est encore plus révolutionnaire : le projet Bradbury. L’auteur Neil Jomunsi, alias Julien Simon, s’est fixé le pari fou d’écrire 52 nouvelles en un an, soit une par semaine. On peut acheter une nouvelle en numérique à l’unité pour 1 euro, ou bien s’abonner pour soutenir sa démarche créative. Pour moi, ce sont des innovations de ce genre qui imposeront le livre numérique, en donnant la possibilité au lecteur de découvrir autrement des univers… et des écrivains.
Dernier paradoxe, et non des moindres : pendant qu’on débat du juste prix d’un ebook, le livre papier continue d’évoluer ! L’impression à la demande permet désormais d’obtenir de beaux ouvrages. C’est un nouveau modèle économique qui se met en place pour les éditeurs et les libraires : non seulement il n’y a plus besoin de stockage, mais les invendus ne partent plus au pilon. Les écrivains en profitent également, puisque la rupture de stock appartient au passé. Leurs livres ne seront donc jamais épuisés. Ironie du sort, cette technologie rappelle furieusement l’époque du moine qui recopiait un livre pour honorer la commande d’un client ! Je suis convaincu que dans les prochaines décennies, les progrès de l’impression 3D autoriseront une révolution encore plus merveilleuse : l’impression à la demande d’objets-livres !
EDIT : on commence à aller vers cette direction, comme le montre ce reportage
Et vous, combien d’euros êtes-vous prêts à investir dans un ebook ?
Il y a deux semaines, la possible découverte des ondes gravitationnelles du Big Bang a provoqué une grande effervescence chez les scientifiques. Si le Big Bang n’est qu’un phénomène banal au sein d’un multivers, cela nous conduira vers une nouvelle physique et des perspectives incroyables : l’éventualité de mondes parallèles.
Il y a quelques années, je suis tombé amoureux d’un documentaire absolument fascinant qui évoquait cette hypothèse : l’univers élégant. Inspirée d’un livre du physicien Brian Greene, cette série en 8 épisodes (tous disponibles ici) est passionnante. Simple d’accès pour le littéraire que je suis, mais également ambitieuse, cette série bouleverse la vision qu’on peut avoir de l’Univers.
Présenté par Brian Greene lui-même, le documentaire revient sur la quête menée par des physiciens : expliquer la totalité des lois physiques à travers une seule théorie susceptible de réconcilier la communauté scientifique ! La science du XXe siècle a en effet connu un schisme terrible. Au siècle dernier, alors qu’Albert Einstein expliquait avec succès sa fameuse relativité des phénomènes cosmiques gigantesques comme la gravitation des planètes, d’autres savants découvraient au niveau de « l’infiniment petit » la mécanique quantique, une physique déroutante… que méprisait Einstein ! « Dieu ne joue pas aux dés ». La mécanique quantique s’appuie en effet sur des statistiques : on peut connaître la vitesse d’une particule ou bien sa position, mais jamais les deux en même temps. Jusqu’à sa mort, Einstein s’isola dans ses recherches afin d’expliquer l’ensemble des lois qui régissent l’Univers via la relativité… en vain. Aujourd’hui, certains chercheurs essaient d’atteindre le Graal, réconcilier la relativité générale d’Albert Einstein avec cette étrange mécanique quantique, à travers une seule et même théorie : la théorie des cordes.
Avec simplicité et intelligence, le documentaire retrace cette formidable aventure qui a presque l’allure d’un thriller. Non seulement on comprend les enjeux présentés, mais on réalise qu’il est possible qu’une nouvelle physique s’impose dans les années à venir. Grâce à l’accélérateur de particules appelé LHC, la machine la plus sophistiquée de l’histoire de l’Humanité, les physiciens du CERN cherchent des particules exotiques comme l’hypothétique graviton, une particule de gravité qui démontrerait indirectement que d’autres dimensions existent ! En effet, la force de la gravité est à notre échelle, étonnamment faible. Dans la vie de tous les jours, un simple aimant permet de défier la gravité en soulevant, par exemple, un clou en métal dans les airs. Mais en réalité, peut-être que cette gravité est aussi forte que l’électro-magnétisme, mais qu’elle est diluée dans notre monde, parce que des gravitons s’échapperaient dans d’autres dimensions supplémentaires que nous ne parvenons pas à percevoir.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, ces dimensions supplémentaires n’ont rien d’étonnant pour les mathématiciens, qui n’ont pas attendu la théorie des cordes pour les intégrer dans leurs réflexions… sans pour autant les voir. Alors comment imaginer des réalités mathématiques qui nous dépassent ? C’est tout le propos d’Edwin Abbott dans son roman allégorique Flatland, écrit en 1884. L’auteur raconte l’histoire d’un carré doté de conscience, qui vit à la surface d’un monde plat en deux dimensions. Sa vie est bouleversée lorsqu’un jour, une sphère apparait devant lui… Est-ce un miracle ? De la magie ? Comment imaginer ce cercle en trois dimensions, cette « sphère » ? D’où vient-elle ? Que de mystères à élucider pour ce carré et son peuple…

Reptiles, de l’artiste M.C. Escher. Pas simple pour ces lézards d’imaginer un monde en trois dimensions…
Flatland illustre poétiquement le fait que nous sommes tous limités par nos perceptions. De loin, un câble électrique ressemble à une simple ligne unidimensionnelle, pourtant si on regarde de plus près, une fourmi peut se déplacer dessus à sa surface sur deux dimensions. C’est précisément ce que nous vivons au quotidien lorsque nous marchons à la surface d’une sphère telle que la Terre. Mais comment imaginer des objets de dimensions supérieures ? Il suffit de regarder un hypercube selon différents points de vue.
Ou d’observer cet hypercube en mouvement
Les dimensions supplémentaires constituent de belles vues de l’esprit, mais qu’en est-il des mondes parallèles ? Dans son livre la réalité cachée : les univers parallèles et les lois du cosmos, Brian Greene envisage très sérieusement l’existence d’autres univers, et explique quelles seraient les différentes possibilités. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les hypothèses sont vertigineuses ! Commençons par la plus banale, admise par une très grande majorité de physiciens et d’astronomes : l’univers est infini. Si ces scientifiques ont raison, il pourrait très bien y avoir d’autres copies du nôtre très loin dans notre espace… D’autres chercheurs pensent plutôt que nous pourrions vivre à l’intérieur d’une bulle dans un multivers inflationnaire qui grossit tel un ballon gonflable. Non seulement notre univers ne serait pas isolé, mais à l’instant où vous lisez ces lignes, d’autres seraient en train de naître perpétuellement. Là encore, il s’agirait d’univers comparables au nôtre : la récente (possible) découverte des ondes gravitationnelles du Big Bang nous rapprocherait de cette hypothèse.
Autre possibilité : un multivers de « branes », des structures décrites par la théorie des cordes, avec trois types d’univers parallèles plus exotiques, comme l’étrange monde riemannien imaginé par Greg Egan. Dans le premier scénario, notre univers, une brane, flotterait dans un gigantesque espace à plusieurs dimensions.
Dans ce cas de figure, les dimensions seraient tout près de nous, tellement minuscules qu’elles seraient cachées dans la matière. Ces dimensions seraient repliées sur elles-mêmes comme des cordes… mais dans l’hypothèse où elles seraient à une distance de 10-18 centimètres, grâce au LHC, les scientifiques du CERN pourrait les détecter ! Second scénario : la collision entre deux branes a provoqué le Big Bang, un événement… banal. Cette collision cyclique se reproduit, encore et encore, ce qui implique que notre univers n’est pas le premier, ni le dernier (personnellement, j’ai l’impression que c’est comme si on formatait périodiquement un disque dur pour réinstaller une partition… vous ne trouvez pas ça un peu humiliant ?). En fait, parler de « premier » et de « dernier » n’a pas de sens, étant donné que les branes évoluent parallèlement dans le temps, comme les époques du film Cloud Atlas.
Troisième et dernier scénario de la théorie des cordes, la théorie du multivers inflationnaire cité plus haut, couplée à des dimensions spatiales supplémentaires, qui donnerait un nombre incroyable d’univers variés. Comme si ce n’était pas déjà invraisemblable, Brian Greene garde le plus étrange pour la fin. Une hypothèse basée sur la recherche quantique des trous noirs : notre univers ne serait qu’une projection holographique d’une réalité différente, l’allégorie de la caverne de Platon. Personnellement, pour me représenter cette idée, j’imagine le reflet d’un miroir, l’illusion de découvrir un univers qui, en réalité, n’est qu’une copie du vrai. Malgré la grande impression de profondeur qu’on peut avoir en face de son image, le miroir peut être extrêmement fin. Si des êtres le peuplaient, ils essaieraient de comprendre les lois de leur univers, sans se rendre compte qu’en réalité leur monde ne serait qu’une résultante de la lumière qui se réfléchit sur le miroir. Toute leur réalité ne constituerait qu’une simple information lumineuse faite de photons, le reflet intime d’un univers lointain… Mais à notre échelle, ce serait encore plus déstabilisant : quoi de commun entre l’image tridimensionnelle d’un hologramme et le plastique éclairé au laser dont cette image est issue ? Si notre univers est un hologramme, bien qu’il partage une même information avec son univers d’origine, il est pourtant radicalement différent de cette « source », la réponse à bon nombre de questions se trouve là-bas… De l’illusion à la simulation artificielle façon Matrix, il n’y a qu’un pas que Brian Greene s’amuse à franchir, avant d’envisager le multivers suprême : tous les univers évoqués précédemment existeraient, car ils incarneraient l’ensemble des équations mathématiques possibles. Ou plutôt : tout serait une émanation des mathématiques, dont les objets fractals se retrouvent dans la nature : les nuages, les flocons de neige, les réseaux de rivières, le brocoli, nos vaisseaux sanguins…
On peut même passer sa vie à explorer, à l’aide de logiciels très simples, des objets mathématiques d’une complexité inouïe, comme l’ensemble de Mandelbrot, étudié depuis près d’un siècle par des savants qui ressemblent plus à des poètes qu’à des mathématiciens…
Les recherches de ces dernières décennies, et la possible découverte des ondes gravitationnelles du Big Bang, donnent le sentiment que nous sommes à l’aube d’une révolution scientifique sans précédent. Après avoir découvert successivement que la Terre, le Soleil et notre galaxie ne sont pas le centre de l’Univers, il n’est pas impossible que l’Humanité réalise que ce même univers, et le Big Bang qui l’a créé, soient aussi communs qu’un grain de sable sur une plage… La physique spéculative ne peut, pour l’instant, déterminer si des civilisations se développent à des distances faramineuses, ou bien à quelques millimètres de nous. Mais en revanche, si la découverte des ondes gravitationnelles du Big Bang se confirme, il est possible qu’un modèle multivers inflationnaire à bulles s’impose dans les années à venir, ce qui constituerait rien de moins que l’acte de naissance d’une nouvelle cosmologie. Grâce à l’opiniâtreté des savants, la physique va peut-être redevenir une métaphysique qui, personnellement, me donne le vertige. Au cours des siècles prochains la distinction entre science, religion et art risque de ne plus avoir de sens. L’Humanité suivra peut-être une philosophie humaniste, basée sur la conscience qu’une force invisible vibre en chaque chose avec des intensités différentes. La conscience que nous sommes tous liés.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les mathématiques semblent bien vivantes, au point où nous en sommes peut-être l’une des émanations. Cette petite vidéo émouvante illustre cette universalité. Elle a été réalisée à partir d’Electric Sheep, un logiciel que j’utilise régulièrement pour admirer les fractales. Avant de lancer la vidéo, imaginez ces fractales comme autant d’univers parallèles, et n’oubliez pas de cliquer sur « plein écran », bon voyage…
– Il faut avoir de l’inspiration pour écrire des livres !
Quel auteur n’a jamais entendu cette phrase au détour d’une conversation ? Ah, « l’écrivain inspiré » ! une idée reçue qui a la vie dure… Bien sûr, je n’en veux pas aux gens de croire en ce stéréotype vieux comme le monde. Chez les Grecs, on parlait volontiers d’extase, de furor poeticus, l’artiste se transformant en possédé !
Les Romains étaient plus pragmatiques : ils distinguaient le talent, l’ingenium, de l’inspiration proprement dite. Mais avec le Christianisme, plus possible d’échapper à une inspiration in spiritum. Cette conception surnaturelle de l’écriture triomphera au XIXe siècle avec les poètes romantiques. Tout cela explique pourquoi l’écrivain est aujourd’hui considéré comme un branleur qui attend tranquillement que les idées tombent du ciel un inactif, et non une personne qui fréquente les ateliers d’écriture pour travailler sa technique. Et même travailler tout court…
Au même titre que le peintre, le romancier a une image de dilettante qui lui colle à la peau. D’ailleurs, les médias rappellent régulièrement que les Français écrivent beaucoup, ce qui renforce l’idée que l’écriture est une activité facile réservée aux oisifs « inspirés ». Pourtant, très peu de gens terminent la rédaction d’un premier roman. Pour franchir ce palier décisif il faut des semaines, des mois, parfois des années de travail et beaucoup de temps et de persévérance, j’en avais d’ailleurs longuement discuté avec vous. Mais qu’est-ce qui peut pousser une personne à se livrer à une activité si ingrate ? En posant la question, on a un début de réponse.
La frustration
Un terme aussi négatif va probablement choquer pas mal d’amis auteurs, et pourtant je pense qu’il est essentiel. Faut-il avoir souffert dans sa vie pour écrire ? A priori, on pourrait répondre que non. La question parait même saugrenue : l’écriture est avant tout une passion, un plaisir ! Enfin, surtout au premier jet… Après l’euphorie des premiers mois, les corrections arrivent ! Quand on travaille des années sur un texte, il faut bien avouer qu’être écrivain peut s’avérer pénible.
Si un auteur s’impose un second métier, en plus d’un travail alimentaire, cela signifie bien évidemment que, pour lui, écrire relève du masochisme d’un besoin essentiel. Que l’on exerce cette activité pour soi ou dans le but d’être publié, peu importe. Tous les écrivains seront à-peu-près d’accord pour reconnaître que l’écriture tient une place importante dans leur quotidien.
Et alors ? Quel rapport avec un éventuel mal-être ?
On ne doit pas forcément avoir vécu des drames insensés pour être « inspiré ». Le pauvre Tsutomu Yamaguchi, seul homme a avoir survécu aux bombardements d’Hiroshima et Nagasaki, n’a jamais ressenti le besoin d’écrire. Avec son horrible expérience, il aurait pourtant pu créer une œuvre artistique comme la magnifique nouvelle de Akiyuki Nosaka, la Tombe des lucioles, qui a d’ailleurs été adaptée par le studio Ghibli. Néanmoins, j’ai le sentiment que la plupart des auteurs ont commencé à écrire parce qu’ils ont, à un moment de leur vie, éprouvé le besoin d’échapper à leur quotidien en racontant une histoire. Comme si l’écrivain ressentait une frustration. Il lit des livres, visionne des films, vit des événements, mais à un moment donné, cela ne suffit plus. Il veut partager un récit plus ou moins imaginaire (je reviendrai sur ce point à la fin).
Bon, d’accord, mais George R.R. Martin n’a pas forcément vécu le quart du dixième de ce qu’il fait subir à ses personnages de Game of thrones !
Oui, et tant mieux pour lui. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas torturé. Récemment, Jérôme Cigut a écrit sur son blog un article passionnant, « écrire sur le vécu ». Au fil de notre discussion, il m’a appris que Stephen King, encore enfant, a vu un ami d’enfance se faire tuer par un train. Bien qu’il n’en ait pas un souvenir clair, cet épisode traumatisant a inspiré à l’auteur sa fameuse nouvelle le Corps, qui a elle-même inspiré le magnifique long-métrage Stand by me. Quand on découvre dans l’autobiographie Écrire l’enfance de Stephen King, il apparait évident que l’auteur a ressenti le besoin de partager ses névroses. Lorsqu’Anne Rice invente le personnage de Claudia pour Entretien avec un vampire, sa fille Michèle vient d’être emportée par une leucémie à l’âge de six ans… Une fois encore, si peu d’entre nous ont vécu d’horribles tragédies, la mort nous concerne tous, hélas. Un deuil n’est-il pas la plus grande des frustrations ?
Le deuil n’est pas forcément le sentiment de perdre un être cher, il peut-être aussi lié à d’autres événements comme le passage à l’âge adulte, ou bien un exil douloureux dans un pays lointain. D’un point de vue plus positif, on peut considérer que l’existence humaine n’est qu’une suite de deuils que chacun d’entre nous devra gérer du mieux possible pour apprécier pleinement la vie à sa juste valeur. Peut-être que l’écrivain ne fait qu’emprunter une voie philosophique particulière pour progresser dans ce lent apprentissage ? Il n’est donc pas le seul à être inspiré au sens large : on peut concevoir qu’un athé puisse devenir chercheur en mécanique quantique afin de comprendre les lois scientifiques qui régissent l’univers, et ainsi donner un sens à sa vie. Un religieux partira dans un pays pauvre s’occuper de personnes défavorisées pour consacrer son existence aux autres et/ou à Dieu. Un athlète de haut niveau se réfugiera dans le sport pour canaliser son agressivité, et se réaliser, tandis qu’un chef d’entreprise parti de rien créera une entreprise qui changera la face du monde…
Nous sommes tous des gens inspirés
C’est d’ailleurs, peut-être, le postulat d’Éric-Emmanuel Schmidt : dans son uchronie la part de l’Autre, Adolf Hitler réussit son concours d’entrée au Beaux-Arts et devient… un artiste, car il a canalisé ses frustrations héritées d’une enfance difficile. Si on part de ce postulat optimiste, au moment de se retrouver devant sa feuille blanche chaque écrivain, célèbre ou inconnu, est à égalité. Quel que soit son vécu, son inspiration, il s’en nourri pour aller aussi loin que nécessaire dans l’émotion. Que l’on écrive un conte pour enfants, ou une tragédie, cette émotion est la matière première qui donne à un livre son caractère universel. C’est pour cette raison que les classements par genres sont si artificiels. On oppose la littérature blanche à celle de l’imaginaire, la réalité à la fiction, mais au final, seule l’émotion importe. Certaines personnes méprisent la littérature jeunesse parce quelle serait « puérile », et pourtant Max et les maximonstres est un récit sombre qui traite de la colère, telle qu’on peut la ressentir durant l’enfance. Inversement, il y a énormément de lumière dans le film la Vie est belle de Roberto Begnini, une histoire qui se déroule en grande partie dans un camp de concentration.
Ces deux oeuvres atypiques sont la preuve qu’on peut, grâce à son vécu, s’approprier certains sujets pour en livrer une (re)lecture différente selon sa propre sensibilité… et son inspiration. Pour Freud, un être humain est, sa vie durant, partagé entre ses pulsions de vie et de mort. À défaut d’être inspiré, peut-être que l’écrivain, comme d’autres artistes, est plus sensible à ce combat Éros vs Thanatos. Pour lui, s’inspirer, c’est souffrir. Mais souffrir, c’est également s’inspirer. À mon humble niveau, en 1999 j’ai vécu l’une des périodes les plus riches de mon existence. J’ai eu le bonheur et la chance de participer à des fouilles archéologiques en Jordanie, non loin de Pétra, mais j’ai également connu la souffrance et la frustration en étant cloué sur un lit d’hôpital pendant de longues semaines, à cause de graves problèmes de santé. Et comme tout le monde, j’ai vécu le deuil d’une rupture…
Cette année là, j’ai beaucoup écrit.
D’autres articles de la blogosphère sur l’inspiration : Nathalie Bagadey, Syven, Vestrit.
PS : un grand merci à Marie Caillet, Célia Deiana, Carole Rxq, Angou Levant, Saile, @ARRIBASNatalia, @avalyn_w et @paindesegle pour les idées de GIF !
Londres, 2013. Peter, un adolescent sans histoires, échappe de justesse à un attentat prémédité par de redoutables ennemis : les « fés ». Il rencontre alors les membres d’une société secrète, les Outrepasseurs. Ces derniers lui révèlent un héritage qui va changer le cours de sa vie…
S’il y a des livres qui ont réussi à me désarçonner, les Outrepasseurs en fait assurément partie. Au bout d’une soixantaine de pages, l’auteur de Au service des insectes nous propulse en plein Moyen-Âge ! Je ne m’attendais pas du tout à ça, et je dois avouer avoir été un moment perdu par les nombreux personnages, ainsi que les changements de point de vue. Etait-ce bien nécessaire ? me suis-je demandé à plusieurs reprises. Eh bien la réponse est oui : à mesure que l’intrigue se ressert sur certains protagonistes, le récit monte en puissance dans son dernier tiers, avec le personnage du Chasseur, un méchant d’anthologie absolument terrifiant (et sensuel), qui m’a un peu rappelé le démon Darkness du Legend de Ridley Scott.
Si vous cherchez un conte de fées façon Walt Disney, passez votre chemin. Le roman de Cindy Van Wilder est une oeuvre sombre, une célébration des inquiétantes fables d’autrefois. Ses créatures se montrent impitoyables, et terrorisent des villageois qui ne peuvent s’en remettre qu’à eux-mêmes… et à un moine qui va mener son enquête. L’auteur dresse un tableau pessimiste de la nature humaine, à travers une vertigineuse plongée dans l’ignorance et le fanatisme. Ses personnages luttent contre de multiples antagonistes, coincés entre deux cultures destinées à se heurter violemment : chrétienté contre paganisme. Les Outrepasseurs sont influencés par le roman de Renart et ses figures animalières cathartiques qui transgressent les tabous de l’époque. Et c’est là où l’écrivain fait preuve d’une grande intelligence : à l’heure où une bit-lit anglo-saxonne parfois stéréotypée inonde les librairies, Cindy Van Wilder s’inspire du folklore européen pour livrer une fantasy francophone ambitieuse, une relecture du mythe du loup-garou.
La romancière a accompli un travail minutieux pour nous restituer l’ambiance pesante qui pouvait planer sur une société traditionnelle du XIIIe siècle marquée par les interdits. Le personnage tragique de Niels, tout en contradictions, m’a interpelé. Ce père de famille, au prime abord détestable, est un homme de son temps : mis sous pression par sa communauté, il se retrouve confronté à un choix moral intenable… Le moins que l’on puisse dire, c’est que Cindy Van Wilder ne ménage pas ses personnages, avec notamment une chasse (au garou) particulièrement poignante.
Au final, ce tome 1 est une longue exposition, certes, mais une exposition nécessaire pour comprendre la psychologie de Peter, un héros schizophrène qui devrait enfin jouer son rôle de protagoniste principal dans le tome 2. Les derniers pages, riches en tension, laissent en effet présager une suite mouvementée !
D’autres avis : la bibliothèque de Glow, Earane, la Pile à lire, Esther, Aelys, À l’ombre des nénufars.
PS : cet article a été rédigé dans le cadre du challenge SFFF au féminin.